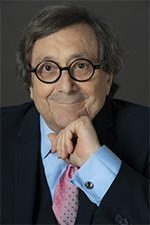L’œuvre de Carole David, exigeante, singulière et rassembleuse, s’attire les éloges depuis la toute première publication de l’écrivaine, en 1986. Non seulement celle-ci a-t-elle obtenu le prix Émile-Nelligan pour son recueil de poésie Terroristes d’amour, mais chacun des 18 autres livres qui ont suivi lui a également valu un prix ou, à tout le moins, d’en être finaliste. Menant ainsi une fructueuse carrière littéraire depuis plus de 30 ans, la poète, nouvelliste et romancière Carole David s’impose comme une figure importante de la littérature québécoise contemporaine.
« Obtenir le prix Athanase-David est bien sûr une consécration, mais c’est surtout pour moi une reconnaissance de mes pairs, un témoignage de leur respect pour l’ensemble de mon œuvre, ce qui a une grande valeur à mes yeux. Je dirais même qu’au-delà de la reconnaissance de mon travail littéraire et du caractère novateur de mon œuvre, c’est un geste fort pour la littérature, puisqu’il porte un travail de l’ombre vers la lumière », se réjouit-elle.
Jeune intellectuelle féministe à la fin des années 1970, Carole David travaille comme chroniqueuse des revues littéraires au quotidien Le Devoir et critique au magazine Spirale, entre autres, avant d’entreprendre une carrière d’enseignante de littérature et de création littéraire au Cégep du Vieux Montréal en 1980. Également titulaire d’un doctorat de l’Université de Sherbrooke, obtenu en 1994, elle se distingue par sa connaissance approfondie des littératures québécoise, américaine et internationale. Elle enseignera jusqu’en 2009, pour se consacrer à l’écriture par la suite.
Carole David est aussi reconnue pour son engagement dans le milieu littéraire. Elle a siégé à plusieurs conseils d’administration, été déléguée dans divers comités de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, et assumé la présidence de la Commission du droit de prêt public, de la Maison de la poésie, puis du comité Littérature au Conseil des arts de Montréal. Elle est aujourd’hui secrétaire du Festival international de littérature. En outre, ses nombreuses présences à des manifestations littéraires à l’étranger témoignent de ses qualités d’ambassadrice de la poésie québécoise. Elle dira que ce qui la rend le plus fière de son foisonnant parcours, « c’est d’avoir réussi à écrire contre vents et marées, à mener de front maternité, écriture, enseignement à plein temps et engagement ».
L’œuvre de Carole David évoque une américanité ancrée dans la pauvreté et la dépossession. Ses sujets, ses figures et son imaginaire puisent dans la culture populaire et la pensée féministe. Certains qualifient Carole David d’écrivaine punk, en raison de sa démarche poétique révoltée, mais aussi pour son écriture hybride et hors norme, entre la prose et la versification. La narration est de plus affirmée, précise et tranchante. De toute évidence, le grand intérêt que l’œuvre de Carole David suscite auprès des plus jeunes générations n’est pas étranger à la fascination de celles-ci pour les thèmes de la contre-culture.
Sylvia et Ann boivent des martinis dans le bar
d’un hôtel à Boston. Leurs robes aux motifs soyeux
s’enroulent autour de leurs doigts; elles se demandent
s’il faut être hantées par la vaisselle et les draps
pour écrire des poèmes dans lesquels les objets volent
entre vers et prose, atterrissent sur les murs
de la cuisine et se fracassent au cœur des images
ou des phrases déclinées durant leurs années
d’apprentissage. […]
Extrait d’un poème de Manuel de poétique à l’intention des jeunes filles, 2010
Lorsqu’on lui demande comment elle envisage la poursuite de sa carrière d’écrivaine, Carole David répond sans hésitation : « Comme tout créateur, je souhaite pouvoir continuer à me renouveler, ne jamais me répéter. Je veux également demeurer en contact avec la jeune génération et rester active dans le milieu littéraire. Le travail d’écrivain est un acte solitaire, dans cette “chambre à soi”. C’est pourquoi il importe de sortir dans le monde, de s’engager, pour rester en lien avec les autres. Néanmoins, ce que je souhaite par-dessus tout, c’est que mes œuvres continuent à circuler. »
Il ne fait pas de doute que Carole David a érigé une œuvre magistrale, qui établit des ponts entre l’intime et le social, où se rencontrent femmes au foyer, marginaux et désœuvrés, tout en y honorant au passage ses origines italiennes. Si on la décrit comme une personne plutôt discrète, c’est assurément à une autrice fougueuse à laquelle on a affaire, dont l’écriture se révèle sans compromis.