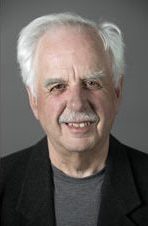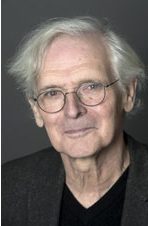Pionnier dans son champ d’études, le professeur et ethnologue Jean Simard se voue à la recherche et à la mise en valeur du patrimoine culturel du Québec depuis plus de quatre décennies. La sauvegarde du patrimoine ethnologique du Québec tant matériel qu’immatériel – l’un des plus remarquables et riche d’enseignements en Amérique du Nord – guide son action encore aujourd’hui.
Jean Simard obtient son doctorat en sciences historiques à l’Université de Strasbourg, reconnue pour sa recherche à l’échelle internationale. Gérard Morisset lui-même, qui a consacré sa vie à la découverte et à la documentation du patrimoine québécois, joue un rôle déterminant dans ses études outre-mer en recommandant sa candidature à une bourse doctorale du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Dans son ouvrage Les Arts sacrés au Québec, Jean Simard reconnaît les qualités de son mentor : « Ce livre est aussi un coup de chapeau à l’homme de terrain, au photographe, à l’écrivain, au pédagogue, à l’homme de synthèse que fut Morisset. »
De 1972 à 2000, Jean Simard est professeur en ethnologie du Québec et de l’Amérique française à l’Université Laval et se spécialise dans l’étude du patrimoine religieux populaire. Pendant plus de deux décennies, il bâtit avec ses étudiants plusieurs grands corpus des traits identitaires des Québécois et de leur vécu religieux. Ce vaste recensement permet le dénombrement de plus de 50 000 artefacts d’imagerie, d’au-delà de 5 000 lieux de culte populaires, de 4 000 objets d’art populaire, de près de 3 000 calvaires et croix de chemin ainsi que de 1 200 statues de plâtre issues d’un atelier ayant eu pignon sur rue dans la ville de Québec. Grâce à cet inventaire systématique et exhaustif, Jean Simard éveille les consciences sur la valeur du patrimoine religieux populaire québécois. Le caractère pionnier de cet exercice contribue à faire reconnaître la singularité et la spécificité de ce patrimoine non seulement au Québec, mais aussi en Amérique et en Europe, où ses travaux trouvent écho.
Expositions, films, émissions de radio et de télévision, conférences et livres sont autant de moyens mis à contribution par ce fervent défenseur du patrimoine pour mieux faire comprendre l’histoire du Québec, une histoire profondément imprégnée par une culture religieuse vieille de quatre siècles.
À l’occasion de la visite du pape Jean-Paul II au Canada, en 1983, on lui confie la production du segment historique de l’exposition Le Grand Héritage pour le Musée national des beaux-arts du Québec. Il contribue également à jeter les bases du Musée des religions du monde à Nicolet. Ouvert à l’expression religieuse contemporaine, ce lieu unique en Amérique explore les fondements des grandes traditions religieuses mondiales afin d’en favoriser la compréhension et d’inciter à une plus grande tolérance à l’égard de la différence. Depuis son inauguration, en 1986, ce musée a présenté quelque 150 expositions.
L’intérêt particulier de Jean Simard pour l’étude du patrimoine funéraire lui inspire la rédaction d’une œuvre colossale : Cimetières – Patrimoine pour les vivants. Dans son ouvrage Le Québec pour terrain – Itinéraire d’un missionnaire du patrimoine religieux, il brosse son propre portrait. « L’essentiel de ma carrière, résume-t-il, a consisté à mettre en valeur le patrimoine religieux, à m’intéresser à son histoire, à son présent et à son avenir, lequel demeure toujours menacé. » Lors de son passage devant la Commission de la culture, dans l’exercice de son mandat d’initiative sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine religieux du Québec, Jean Simard affirme d’ailleurs que « le seul patrimoine qui survivra, c’est celui que l’on revendiquera. »
Encore aujourd’hui, Jean Simard continue de défendre le patrimoine et de partager ses connaissances avec le grand public de multiples façons afin d’enrichir le savoir ethnologique du Québec. Il est le récipiendaire de nombreuses distinctions qui soulignent la valeur de son œuvre, dont le prix Hommage du comité francophone d’Icomos-Canada, le prix Marius-Barbeau de l’Association canadienne d’ethnologie et de folklore ainsi que la médaille Luc-Lacourcière attribuée par l’Université Laval à l’auteur du meilleur ouvrage sur l’ethnologie des francophones en Amérique du Nord. Son œuvre, vivante, instructive et toujours d’actualité, obtient la reconnaissance du milieu et rayonne internationalement. Plus encore, elle lui vaut le respect des communautés étudiées, peu importe leur culture d’origine.