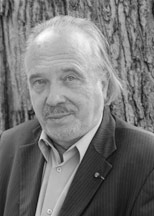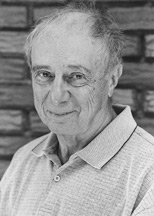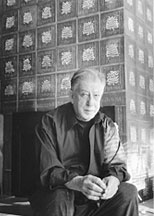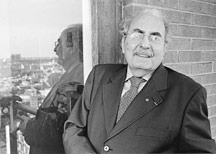Le Québec est aujourd’hui doté de l’une des meilleures entreprises de services transfusionnels au monde, et c’est grâce au leadership et au sens de l’innovation de Francine Décary, présidente et chef de la direction d’Héma-Québec. Depuis 1998, Héma-Québec remplit sa mission de façon exemplaire et a su gagner la confiance de la population. Devenue synonyme de sécurité, l’entreprise a récemment obtenu l’agrément de l’American Association of Blood Banks, association réputée qui regroupe 2 000 banques de sang et centres de transfusion aux États-Unis et partout au monde.
Comment un tel défi a-t-il pu être relevé avec autant de brio? « Il n’y a pas de recette miracle, affirme Francine Décary. Dès mon entrée en fonction, j’ai opté pour la transparence. » En fait, la fondatrice d’Héma-Québec sait imposer au départ une approche unique aux services transfusionnels, beaucoup plus près des personnes et avec un souci extrême de la gestion des risques. Cette vision humaine et pragmatique de la gestion des services transfusionnels lui vient en grande partie de sa longue expérience à titre de gestionnaire à la Croix-Rouge canadienne.
Hématologue de formation et chercheuse scientifique, la docteure Décary a travaillé pendant vingt ans comme directrice de divers services transfusionnels de l’ancien fournisseur de produits sanguins. « Je savais ce qui fonctionnait et ce qui méritait d’être amélioré », dit-elle, fière du chemin parcouru. Pour Francine Décary, un des défis consistait, entre autres choses, à personnaliser le don de sang : « J’ai voulu lancer un message clair : il faut donner du sang, non pas pour Héma-Québec, mais pour les receveurs, ceux qui en ont besoin. » La présidente mettra aussi sur pied un conseil d’administration formé de représentants de toute la chaîne transfusionnelle, des donneurs jusqu’aux receveurs en passant par les médecins et les administrateurs.
Il n’est pas étonnant qu’une telle décision ait été prise. Cette gestionnaire de haut niveau a toujours eu le bien-être des malades à coeur. Son père, lui-même médecin cardiologue, l’a beaucoup influencée dans son choix de carrière, mais c’est un événement bouleversant, dont elle se souvient encore 35 ans plus tard, qui l’a vraiment propulsée en médecine transfusionnelle. Alors qu’elle est jeune médecin à l’Hôtel-Dieu, Francine Décary doit soigner un patient atteint de leucémie en phase terminale. Sa détresse est immense, car, malheureusement, aucun traitement n’existe pour ce type de leucémie à cette époque. « J’étais impuissante, dit-elle. Ce patient m’a motivée à faire de la recherche. »
C’est ce que Francine Décary fera pendant plusieurs années. Sa formation terminée en hématologie à l’Université de Montréal, elle se spécialise en banque de sang et en transfusion au New York Blood Center pendant deux ans. En 1973, au milieu de la vingtaine, elle décide de faire un doctorat en immuno-hématologie à l’Université d’Amsterdam où elle soutiendra sa thèse. Douée pour les langues, elle la défend même, à la grande surprise de son jury, en néerlandais. La Croix-Rouge canadienne la recrute ensuite comme directrice médicale. Avec les années, Francine Décary prend goût à l’administration au point de terminer une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Université de Sherbrooke en 1996.
Lorsque le ministre québécois de la Santé de 1998 pressent Francine Décary pour créer une nouvelle entité de services transfusionnels, elle ne mesure pas l’ampleur du défi. « Je ne vois jamais les obstacles quand j’entreprends quelque chose », déclare-t-elle. Femme d’équipe et de terrain, elle a pour premier réflexe de rencontrer la population à la grandeur du Québec : « Il fallait rallier les employés et les milliers de bénévoles qui avaient la Croix-Rouge tatouée au coeur. » Pour répondre aux besoins des 70 000 personnes qui reçoivent chaque année des transfusions sanguines au Québec, Héma-Québec peut compter aujourd’hui sur la collaboration de ses 16 000 bénévoles et le travail soutenu de ses 1 300 employés.
Se considérant elle-même comme une agente de changement, Francine Décary est une fonçeuse à l’esprit pratique. Malgré son vif penchant pour la gestion, elle veille toujours à faire progresser la recherche et le développement. À la Croix-Rouge, elle a mis sur pied, notamment, un laboratoire de sérologie pour les plaquettes sanguines et a contribué activement à la création du Fonds Bayer pour la recherche et le développement. Depuis qu’elle dirige la destinée d’Héma-Québec, elle a formé une équipe d’une quarantaine de chercheurs, située à Québec, qui travaille dans les trois domaines suivants : ingénierie cellulaire, recherche opérationnelle et bioproduction. L’entreprise a aussi intégré la recherche et le développement en greffe de tissus humains et, sous la direction de la docteure Décary, la première banque publique québécoise de sang de cordon ombilical a été créée.
Alors que les premières années de sa carrière ont surtout été consacrées à la création de l’entreprise et à l’enracinement de sa crédibilité, Francine Décary entend maintenant accorder une attention particulière à la qualité de vie au travail. Elle est consciente de l’importance d’instaurer des mesures de conciliation travail-vie personnelle à Héma-Québec alors que 80 p. 100 du personnel est féminin. Son prochain défi consistera aussi à assurer une relève en médecine transfusionnelle, domaine qui attire peu de candidats compte tenu des risques perçus à l’égard d’une telle activité.
Première Québécoise présidente de la prestigieuse Société internationale de transfusion sanguine depuis 2002, Francine Décary est aussi profondément engagée dans la promotion des arts. Ayant conservé de sa jeunesse une grande passion pour le piano et la musique contemporaine, elle assume la vice-présidence de la Société de musique contemporaine du Québec à l’invitation de Walter Boudreau, directeur artistique et ami de longue date. « J’apprécie cette musique, dit-elle, car elle reflète bien les angoisses de notre époque. »
Femme d’affaires accomplie, lauréate de divers prix décernés par le Réseau des femmes d’affaires du Québec, la Fondation Y des femmes de Montréal et Hydro-Québec, la docteure Décary passera certainement à l’histoire pour avoir réussi à mobiliser des milliers de personnes dans la création d’Héma-Québec. Au bénéfice de la société québécoise, cette championne a su faire de cette entreprise un fleuron dans le domaine des services transfusionnels dont plusieurs pays commencent à s’inspirer.