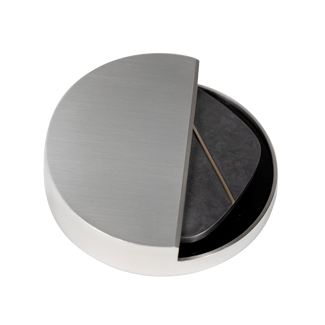Helen Doyle s’impose comme une voix incontournable du cinéma documentaire depuis plus de cinq décennies. Son approche résolument féministe et empreinte d’humanité, combinée à sa volonté constante d’innovation et d’expérimentation artistique, alliant fiction, poésie, information et émotion, lui permet d’attirer l’attention sur des enjeux sociaux et politiques avec autant d’acuité que d’audace. Pionnière de l’art vidéo au Québec, la réalisatrice et scénariste a su faire de son engagement et de sa créativité les points d’ancrage d’un parcours qui se révélera remarquable et des plus inspirants, notamment pour les jeunes générations de femmes cinéastes et vidéastes.
Recevoir le prix Albert-Tessier représente pour Helen Doyle une occasion « de remercier ceux et celles qui [l’]accompagnent depuis [ses] premiers balbutiements pour devenir une « fille des vues ». Je pense particulièrement à toutes ces personnes derrière et devant la caméra qui m’ont fait confiance, qui m’accompagnent encore dans mes efforts de créer des « tatouages de la mémoire » », précise-t-elle.
C’est au sein de Vidéo Femmes, l’un des premiers centres de production, de diffusion et de distribution d’œuvres vidéographiques et cinématographiques féministes au Québec, dont elle participe à la fondation en 1973, qu’Helen Doyle amorce sa prometteuse carrière de documentariste. Ses premiers films, dont plusieurs sont réalisés en collaboration, accordent une place centrale à la libération de la parole féminine. Parmi ceux-ci, notons Philosophie de boudoir (1975), qui dénonce le caractère archaïque du Salon de la femme de Québec; Chaperons rouges (1979), qui traite des violences sexuelles et sexistes à l’endroit des femmes; C’est pas le pays des merveilles (1981) et Les mots… maux du silence (1982), portant respectivement sur la santé mentale et l’isolement des femmes.
Plus tard dans les années 1980, après avoir quitté le collectif, Helen Doyle s’oriente davantage vers le cinéma, continuant de façonner sa signature singulière en explorant de nouveaux thèmes. Dans Le rêve de voler (1986), la cinéaste revisite le mythe d’Icare, en mettant en lumière l’univers fascinant des trapézistes, alors que dans Je t’aime gros, gros, gros (1994), elle propose une célébration de la rondeur, sur un ton humoristique et dans un esprit fantaisiste. C’est néanmoins avec Le rendez-vous de Sarajevo (1997) que la filmographie d’Helen Doyle connaît un véritable tournant, inaugurant une nouvelle étape de création, cette fois-ci basée sur une réflexion sur la guerre, la barbarie et l’engagement artistique.
En 2000, déterminée à poursuivre sur ce chemin jusque-là peu exploré dans son œuvre, la réalisatrice fonde sa propre maison de production : les Productions Tatouages de la mémoire. S’ensuit la création de documentaires tous plus percutants les uns que les autres. Sous la forme de fiction documentée, Soupirs d’âme (2004) porte un regard bouleversant sur le sort des enfants abandonnés et victimes des guerres, en faisant se côtoyer de manière inédite danse, photographie et document d’archives, soutenus par une narration personnelle. Puis, dans Birlyant, une histoire tchétchène (2008), Helen Doyle aborde le conflit tchétchène à travers la vie d’une musicienne. Tous deux produits par InformAction Films, Les messagers (2002) expose la mobilisation d’artistes en contexte de violences guerrières, tandis qu’avec Dans un océan d’images (2013), la cinéaste braque les projecteurs sur le travail des photojournalistes en zones de combat. Sa plus récente offrande cinématographique, Au lendemain de l’odyssée (2024), met en lumière la traite des femmes nigérianes. Abondamment récompensés au Québec comme à l’international, ces deux derniers films révèlent une fois de plus le talent extraordinaire de la documentariste à concevoir et à réaliser des œuvres aussi poignantes qu’empreintes d’espoir.
Quand on lui demande de quel accomplissement professionnel elle est la plus fière, Helen Doyle répond d’emblée son plus récent film, Au lendemain de l’odyssée, avant de nuancer : « Mais je me sens comme le Petit Poucet : chacune de mes réalisations représente un petit caillou que je laisse sur mon passage [et] qui me permet à la fois de baliser mon parcours et de faire quelques retours en arrière pour mieux me projeter dans l’avenir. »
Tout au long de sa carrière, Helen Doyle a créé des objets de mémoire, de résistance et de dialogue, à travers une œuvre documentaire riche, au langage visuel distinctif, qui lui a valu de nombreux prix aussi bien au Québec et au Canada qu’à l’étranger. Son parcours brillant et son originalité font d’elle une cinéaste d’exception, incarnant parfaitement l’alliance entre l’exigence artistique et l’engagement social. Pour l’avenir, elle dit souhaiter « continuer de jouer un rôle de passeuse ». « Les femmes artistes, on ne peut pas s’asseoir sur nos modestes acquis. Il faut encore que nous fassions notre place dans toutes les formes d’art », souligne-t-elle en terminant.