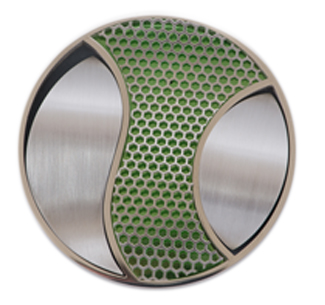Son ami Félix Leclerc a écrit : « Il faut savoir tremper sa plume dans le bleu du ciel. »
Jean Royer l’a su, si bien su. Poète, essayiste, journaliste culturel et critique littéraire, il a porté la littérature et la poésie dans son âme. À aimer lire, à faire découvrir et à donner forme à cet art, il l’a incarné autant par son être que par son œuvre. Un désir de transmission né dans une société où l’on devait taire… et se taire.
Alors qu’il est étudiant dans un Québec qui piétine, au temps de Duplessis et des livres à l’Index, Jean Royer rêve de découvrir sa propre culture, et surtout sa propre littérature. Or, pendant ses études au Séminaire de Québec et à l’Université Laval, on lui enseigne la littérature française en lui signalant à peine les œuvres québécoises de Roger Lemelin et d’Anne Hébert.
Puis, après ces heures sombres, surviennent la Révolution tranquille et le besoin d’émancipation. Jeune adulte à cette époque, Jean Royer assiste et participe à la naissance d’une culture québécoise qui nous est propre. « Je suis un produit de la Révolution tranquille. C’est-à-dire que j’avais 20 ans en 1960. Je suis arrivé à un moment charnière de notre histoire sociale, politique et culturelle, déclare-t-il. Moi et bien d’autres, nous étions à la recherche de nous-mêmes, de notre culture. J’ai été imbu de cette découverte et de cette volonté de transmission. »
En 1963, lorsque Jean Royer fait son entrée comme journaliste à L’Action catholique (un quotidien de Québec concurrent du Soleil), aucune page culturelle n’existe comme telle, à l’exception de celle du journal Le Devoir. Il remercie donc le chroniqueur littéraire en poste, un prêtre, pour inaugurer une page littéraire signée uniquement par des critiques laïcs. Puis, il embauche un critique de cinéma et le cahier passe à deux pages, puis à quatre et à six. « C’était l’époque bénie de la chanson populaire. Donc la culture savante pouvait verser dans la culture populaire », décrit-il.
Après un passage au journal Le Soleil de 1974 à 1977, Jean Royer devient le premier journaliste à occuper le poste de directeur des pages culturelles au quotidien Le Devoir, le cahier Culture & Société, qu’il formatera en 1978 et dirigera jusqu’en 1991. Fait d’exception : il impose l’entretien littéraire à la une de ce cahier. « Ce n’était pas automatiquement l’écrivain français de passage au Québec qui avait l’entretien à la une, explique-t-il. C’était plutôt un écrivain québécois en priorité. En page trois, il y avait toujours la critique d’un livre québécois et le livre français arrivait en page cinq. Il fallait se donner le droit et la page de droite. »
Jean Royer fait donc sa marque en introduisant l’entretien littéraire au Québec, un genre peu pratiqué avant lui. Julio Cortazar, Milan Kundera, Marguerite Duras – pour ne nommer que ceux-là –, il rencontre plus de deux cents écrivains d’une vingtaine de littératures, « sa plus grande fierté de journaliste littéraire ». « Je voulais avoir accès à mon siècle, affirme-t-il. Et le chemin pour le faire a été de rencontrer les écrivains. […] On ne peut exister seul. Ainsi, notre littérature s’est sans cesse nourrie des autres littératures du monde. Voilà pourquoi j’ai voulu confronter nos écrivains à ceux venus d’ailleurs. »
Tous ces entretiens sont aujourd’hui regroupés dans les six recueils de la série Écrivains contemporains. Ces contacts précieux avec des auteurs, il les doit aux organisateurs de la Rencontre québécoise internationale des écrivains, créée en 1971. Des gens qui lui ont ouvert le chemin vers les écrivains du monde. « Ces rencontres étaient très exigeantes, avoue-t-il. Pour être à l’aise et aller chercher les intentions littéraires réelles, il fallait tout connaître ce que l’écrivain avait fait, jusqu’à son plus récent livre. » Ainsi, on pourrait croire qu’il a tout lu. C’est presque vrai.
S’il sait faire rayonner la littérature, le journaliste et critique s’affirme également comme essayiste et poète en publiant une quarantaine de titres, dont quelques ouvrages de référence sur la poésie québécoise. L’Arbre du veilleur, paru en 2013 et suivi en mai 2014 de La voix antérieure, devient « son dictionnaire amoureux de la poésie ». Un ouvrage humaniste qui ne verse ni dans la théorie ni dans le jargon. Un livre qu’il présente en fait comme « un labyrinthe pour amener les gens à visiter les poètes. » Dans son Voyage en Mironie, Jean Royer montre largement son admiration, sa fidélité et une vie littéraire commune avec Gaston Miron, son ami et mentor.
Dans le milieu, Jean Royer se révèle comme l’un des rares hommes à mettre en scène l’amour dans sa poésie, l’amour comme un échange. Le secret de ses poèmes : garder sa plume près de son cœur. Ainsi, il se plie aux inflexions des émotions pour proposer une œuvre sensible. Son credo à la poésie l’exprime fort bien : « Elle est mère. Elle est père. Elle est monde et toi. »
De plus, son écriture s’ancre dans un univers qui lui est familier. Ses trois récits – La Main cachée (1991), La Main ouverte (1996) et La Main nue (2004) – composent un hymne à la mère et à la femme. « Ma recherche sur l’amour provient de l’amour maternel. C’est fondamental. C’est la source. Mon monde de formation a été ma mère. » Du même souffle, il ajoute que ses trois récits renferment aussi l’idée de l’émancipation de la femme comme moyen de renouveler la vision du monde. « La part féminine oubliée de l’humanité, jamais pour moi. »
Autant la poésie est « sa vie spirituelle », autant ses actions témoignent de sa foi en cet art. Jean Royer est membre du comité organisateur de la Nuit de la Poésie du Gesù, à Montréal en mars 1970. L’année suivante, il organise, avec Winston McQuade, une nouvelle Nuit de la poésie au théâtre d’été Le Galendor, qu’il a fondé et dirigé jusqu’en 1973 à l’île d’Orléans. À cette époque, il fonde aussi la Revue Estuaire, la seule revue de poésie qui perdure après 38 ans d’existence.
À la suite de Gaston Miron et d’Alain Horic, il reprend la barre, comme directeur littéraire, des Éditions de l’Hexagone (1991 à 1998). Dans le même esprit, il occupe la présidence de la Rencontre québécoise internationale des écrivains et de l’Académie des lettres du Québec (1996 à 2005). « Mon attachement aux institutions s’inscrit dans mon respect pour la génération de Gaston Miron, soutient-il. Il a fondé l’Hexagone avec des amis. D’autres ont lancé la Revue Liberté. Certains ont créé le service des émissions culturelles de Radio-Canada. Cette génération a mis en place les structures, et la mienne a travaillé à leur consolidation. Je crois qu’il doit y avoir une articulation institutionnelle dans une culture. »
Au fil du temps, l’œuvre de Jean Royer inspire d’autres artistes; certains de ses poèmes sont mis en musique par Éric Champagne et par Gilles Bélanger ou encore matérialisés dans l’espace public à Québec et à Namur par les chaises-poèmes du sculpteur Michel Goulet. À ces réalisations s’ajoutent des actions pour le rayonnement de la littérature, que ce soient les tournées en France et au Mexique, la présidence d’un colloque sur Anne Hébert à l’Université Paris-Sorbonne ou encore la direction d’un hommage à Gaston Miron à la Maison de la poésie de Paris.
Tout compte fait, les trois pans de son parcours, soit comme journaliste, écrivain et gardien des institutions, ont fait de Jean Royer une figure majeure du monde littéraire québécois. Toute sa carrière est vouée à faire entendre la littérature et, ensuite, à la faire entendre mieux.
C’est donc après le prix Alain-Grandbois de l’Académie des lettres du Québec, le prix Claude-Sernet reçu en France et une nomination à l’Ordre des francophones d’Amérique qu’il reçoit le prix Athanase-David. « C’est le plus beau cadeau que l’on puisse recevoir de ses pairs et de l’État du Québec. En plus, je le recevrai des mains de la petite-fille d’Athanase David. Ce geste me touche beaucoup en raison de la transmission qui a été mon idée phare depuis mes 20 ans, la transmission de notre culture et de notre littérature », conclut le lauréat.