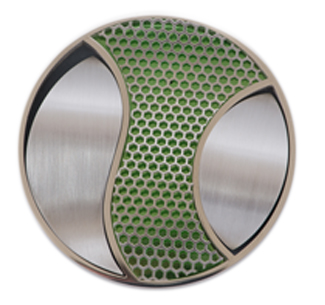En un peu plus de vingt-cinq ans, Robert Morin a signé une trentaine d’œuvres, courts, moyens et longs métrages, en vidéo ou sur pellicule. Treize rétrospectives de ses productions ont eu lieu au Québec, au Canada, en France, en Belgique et en Suisse. Il a reçu plusieurs prix, dont celui du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2009. Et voici que le prix Albert-Tessier du Québec vient couronner son œuvre, vaste et importante, à nulle autre pareille. Ce travailleur infatigable qui, depuis les années soixante-dix, n’a cessé de multiplier les projets, d’imposer non seulement son style et sa vision du monde, mais une manière de faire du cinéma et de la vidéo en artiste qui n’accepte aucun compromis, mû par l’urgence de filmer, de « fouiller, comme il dit, les rêves et la vie des gens ».
D’entrée de jeu à notre rencontre, il affirme fortement son statut d’indépendant farouche : « Je n’ai jamais voulu que mon statut d’artiste soit contaminé par les diktats de l’industrie et des institutions. Pas question pour moi de faire un cinéma gentil, de réconforter le spectateur ». Effectivement, ses œuvres, traversées par la violence et la cruauté, supportées par un regard incisif sur la société, ne peuvent guère recevoir l’assentiment de tous. « On nous parle du public à rejoindre, mais moi, je ne suis pas un commerçant, je m’affirme comme un artiste. Picasso ne pensait pas à un public en particulier quand il peignait. On ne devrait jamais parler de publics en art et en culture. »
Catégorique, Robert Morin? Oui, mais avec une position venue de la pratique et non de la théorie, de films produits à faible budget et beaucoup de débrouillardise, des œuvres non formatées pour le marché et dont les genres sont brouillés. Le cinéma est pour lui une exploration dans laquelle n’existent pas de différences entre vidéo et cinéma, entre documentaire et fiction. Pas de recettes chez lui. Dynamiter les pistes et les frontières entre les genres lui a permis de rester fidèle à sa morale, à une posture intransigeante. Il a ainsi construit une œuvre cohérente dans ses thèmes et rigoureuse dans sa diversité. Quels que soient les moyens et les méthodes, il a donné des films incontournables pour le cinéma québécois, et qui ont influencé toute une jeune génération venue après lui. Cet expérimentateur de la narration et des formes esthétiques s’est voulu un témoin de l’existence humaine, de ses drames, de ses tragédies. Mais comment en est-il venu là?
Réalisateur, scénariste, acteur et directeur de la photographie, Robert Morin est né à Montréal en 1949. Étudiant en communication au Collège Loyola, il est plutôt attiré par la photographie et la peinture. Il avoue qu’il n’était pas un fan du septième art et qu’il ne se voyait pas devenir réalisateur à cette époque. C’est pour gagner sa vie qu’il devient caméraman. De fil en aiguille, il est amené à fonder en 1977 la Coop Vidéo avec, entre autres, Lorraine Dufour (monteuse de presque tous ses films et coréalisatrice durant vingt ans), Jean-Pierre St-Louis et Marcel Chouinard, maison de production devenue depuis l’une des plus importantes du cinéma québécois.
C’est par hasard qu’il tourne sa première vidéo, Gus est encore
dans l’armée (1980). Détournement de chutes d’un film de commande de l’Office national du film pour lequel il était directeur photo, ce faux home movie lui donne la piqûre du cinéma. On y voit déjà l’ébauche d’une méthode de travail et d’une approche du filmage qui s’affirmeront au cours des ans. Robert Morin devient alors, comme il le dit, « un gars qui montre des vues » qu’il appelle des « tapes existentiels ». Quand on lui demande de définir ces tapes, il répond que ce sont « des vidéos qui soulèvent des questions sur l’existence, n’apportent aucun message, ne donnent pas de modèles. Ce qui importe est de donner une image de la beauté et de la futilité de l’existence ». Ainsi, Ma vie, c’est pour le restant de mes jours (1980), Mystérieux Paul (1983), Le voleur vit en enfer (1984), La réception (1989) et ce chef-d’œuvre des vidéos existentielles qu’est Quiconque meurt, meurt à douleur (1996) montrent des individus marginaux, qu’ils soient des hors-la-loi, des laissés-pour-compte ou des drogués, qui mettent en scène leur propre vie.
Sont-ce des documentaires? Justement non. Il est difficile de les classer dans ce genre tant ces vidéos ne suivent aucune des conventions attribuées au documentaire. Robert Morin, qui a connu le cinéma direct, le dit : il a toujours voulu s’éloigner de la simple observation des personnes, adoptée par les cinéastes de ce mouvement. « Je n’ai jamais fait de documentaire, confie-t-il. Même, que je n’aime pas trop ça, le documentaire », souligne-t-il. La fiction l’intéresse donc avant tout. C’est en collaborant étroitement avec les gens et en voulant les aider à déballer leurs rêves, leurs fantasmes, leurs espoirs qu’il façonne ses films comme des fictions. Le filmage devient une manière d’entrer – parfois violemment – dans le quotidien des gens, de s’immerger entièrement dans leur vie. Le vidéaste imposera ainsi pendant dix ans sa signature si singulière par des courts et des moyens métrages, pour se lancer à partir de 1987 dans le long métrage, plongeant de plus en plus dans le romanesque.
Ces longs métrages le feront alors connaître hors de la sphère des aficionados de la vidéographie. Ils confirmeront auprès de la critique et des cinéphiles son statut unique de réalisateur : indépendant, orgueilleusement indépendant même, qui continue à débusquer les fausses valeurs de la société et à détruire les conventions du cinéma. Sa méthode : l’imprécation dans le propos et la témérité dans l’esthétique. Pas de quartier, pas de faux-fuyants chez lui. Il filme dangereusement.
Si Robert Morin brasse encore les mêmes thématiques avec ses longs métrages, son attitude se modifie, devenant toujours plus exigeante, plus radicale. Il se fait plus cruel dans le regard, plus polémique, plus colérique. Ses œuvres sont plus vives et denses, de véritables coups de tonnerre dans le ciel d’un paysage cinématographique trop formaté selon lui, conformiste, complaisant, mou. Ses personnages de paumés, de voleurs, de drogués doivent devenir des révélateurs : rendre visible ce qui est caché dans la société. En allant au-delà des apparences, le cinéaste fait revenir le refoulé. Ce qui demande une grande rigueur dans la démarche et une volonté d’inventer hors des sentiers battus. Savoir ce que l’on veut.
Son moyen à lui est de trouver ce qu’il appelle un concept pour chacun de ses films. Ainsi, dans Tristesse, modèle réduit (1989) son premier long métrage, son concept est de mettre en parallèle déficience mentale (un jeune enfant handicapé intellectuellement) et déficience sociale (la banlieue). Dans son formidable Requiem pour un beau sans-cœur (1992), qui narre la dernière journée d’un détenu en fuite, l’histoire policière doit être vue sous différents points de vue. Dans Quiconque meurt, meurt à douleur, il s’agit de se mettre de l’autre côté de la barrière, d’être avec les toxicomanes et de les faire jouer. Le Nèg’ (2002), film controversé s’il en est un, se veut un exercice de style à la Queneau où chaque séquence est identifiée à un élément du langage cinématographique (champ-contrechamp, caméra fixe, caméra à l’épaule, infographie, etc.). Dans Papa à la chasse aux lagopèdes (2009), un escroc enregistre son témoignage pour ses filles, un journal filmé qui est à la fois l’aveu d’une culpabilité et le désir d’une rédemption.
Cette forme sera reprise dans Journal d’un coopérant (2010) où le cinéaste joue avec le vrai et le faux, l’aspect positif d’un sympathique spécialiste en terre africaine se renversant (il est pédophile). Le long métrage le plus impitoyable et le plus grave de Morin, Petit Pow ! Pow ! Noël (2005) est le règlement de compte d’un fils (le réalisateur lui-même) envers son père (agonisant), avec une caméra aussi menaçante qu’un revolver. Et le concept de son plus récent film, Les 4 soldats, récit futuriste raconté à la première personne, est celui du conte : lieu non indiqué, intemporalité, personnages correspondant à des archétypes, universalité du récit (la guerre).
L’imagination chez ce cinéaste engagé férocement au cœur du quotidien est inséparable du regard critique qu’il porte sur la société. Regard-scalpel ; filmage-dissection. Le film s’apparente alors à un paradoxe : il doit diviser, déranger le spectateur, perturber sa quiétude, fracasser son confort tant social qu’intellectuel. Son œuvre décapante nous interpelle, exige de nous de vivre intensément. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, prendre des risques. Ce qu’a toujours fait Robert Morin. Et sa plongée dans la vie, si dérangeante qu’elle puisse être, est inouïe.