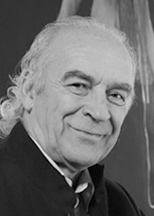Né à l’aube de la Grande Crise, élevé dans une famille modeste qui a su malgré tout attiser son sens de l’émerveillement, Roland Lepage illumine les scènes de théâtre et l’écran de nos téléviseurs depuis bientôt soixante-cinq ans. Ce natif de Québec, dont l’esprit et le cœur n’ont pas de frontières, a participé de tout son être aux années d’affirmation nationale et œuvré à l’épanouissement des écritures d’ici, tout en multipliant les voyages en France, en Italie, en Angleterre et ailleurs. Cet homme amoureux de la langue française, mais aussi polyglotte et désireux de bâtir des ponts entre les pays et les cultures, a déployé son art magistral en quelque cent productions théâtrales. Il n’a cessé de témoigner, de toutes les manières et en excellant dans tous les métiers du théâtre – interprétation, direction artistique, enseignement, écriture, traduction –, de la très haute idée qu’il se fait de son métier, de sa langue et des arts de la scène.
Élève au Petit Séminaire de Québec, il poursuit des études classiques et – fait très rare – obtient à l’âge de vingt ans une licence ès lettres (latin, grec, français) à l’Université Laval. Parallèlement, dès l’adolescence, il monte sur les planches et joint les rangs des Comédiens de la Nef, compagnie fondée à Québec par Pierre Boucher avec, entre autres, Paul Hébert. Et dans l’immédiat après-guerre, il se retrouve à Bordeaux, où il interprète entre autres Molière, Marivaux, Cocteau, Giraudoux – le même Giraudoux dont il adaptera plus tard La Folle de Chaillot – et grandit comme jeune acteur dans l’esprit de l’homme de théâtre français Jean Vilar, fondateur du Festival d’Avignon, qui cherche à rendre le théâtre accessible au plus grand nombre.
Quelques allers-retours entre la France et le Québec, et voilà Roland Lepage installé à Montréal, où il joue pour le Théâtre Club, pour l’Égrégore, auprès des défricheurs du théâtre de cette époque, et participe à la fois en tant qu’acteur et auteur à l’âge d’or de la radio et de la télévision jeunesse de Radio-Canada. Ainsi, de sa voix d’orgue imposant le respect et la tendresse, il enchante des générations d’enfants étendus à plat ventre sur le tapis du salon et rivés à La Ribouldingue et aux facéties de Monsieur Bedondaine. Ces mêmes enfants, devenus grands, n’oublieront pas de sitôt la manière recueillie, marmoréenne, avec laquelle il saura transmettre la parole de Daniel Danis, de Victor Hugo, de Corneille ou de George Bernard Shaw, sans fausse hiérarchie, avec une royale équanimité. Ardent défenseur d’une parole québécoise, le traducteur et adaptateur qu’est aussi Roland Lepage entre en dialogue intense et vibrant avec Tchekhov et Goldoni, Garcia Lorca et Ettore Scola, ou avec David Rudkin.
L’écriture, destinée à un jeune public ou aux grandes personnes qui n’ont pas oublié d’où elles viennent, quels liens les unissent au passé et à leur histoire, demeurera la ligne de basse continue de la vie de Roland Lepage, qui jamais ne s’interrompra et accompagnera et soutiendra toutes ses autres formes de création. L’amitié d’André Pagé, un homme qui aura une importance capitale dans sa carrière, l’amène à œuvrer à l’École nationale de théâtre du Canada au début des années 70, cette période de bouillonnement exceptionnel au cours de laquelle une dramaturgie québécoise voit le jour, désencombrée des modèles français et proprement souveraine. Ainsi écrit-il des textes d’abord créés par les étudiants de l’École et qui connaîtront ensuite une large diffusion. Le Temps d’une vie, l’une des pièces les plus jouées de notre répertoire et qui lui a valu en 1979 le Trophée Chalmers pour la meilleure pièce canadienne présentée à Toronto, La Complainte des hivers rouges, puis La Pétaudière, Icare, même ses traductions et réappropriations d’œuvres étrangères porteront la marque de sa voix, de son style, de ses préoccupations, de sa vision humaniste et fraternelle du monde, de son amour indomptable de la langue.
Un amour tout aussi incoercible qui l’amènera à mordre dans la prose de Jean Marc Dalpé – « j’aime m’en mettre plein la bouche », dit-il avec gourmandise! – ou de tant d’autres auteurs d’ici et d’ailleurs avec un mélange de gouaillerie, de respect et d’admiration non feinte. Pas étonnant qu’il ait été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française en 1995 « en reconnaissance pour services rendus à la culture française ». Aussi à l’aise dans les fourberies moliéresques que dans le drapé racinien, le comédien Roland Lepage sait déployer un jour son goût pour les branquignolleries et affirmer le lendemain sa haute compréhension du tragique, son sens de l’Histoire et son aisance à porter haut et fort les verbes les plus exigeants. Ainsi, entre la drôlerie et l’inquiétude, entre la fantaisie et l’absolue vérité du sentiment, entre les personnages clownesques de La Boîte à surprises et la clairvoyance et la sagesse d’un Phoenixdans l’Andromaque de Racine ou d’un Tirésias dans l’Antigone de Sophocle, Roland Lepage a manié avec légèreté et en déjouant les étiquettes le plaisir de séduire, de faire rire, d’éveiller et de conscientiser. Il a aussi sans cesse réaffirmé qu’il ne saurait y avoir aucune création vivante qui vaille si elle ne se rattache à la fois à la nécessité absolue de l’invention et à la prise en compte de ce qui nous a été légué, et qu’il convient sans fin de réactiver.
Avec rigueur, rectitude, courage même parfois, avec, sans contredit, une morale de l’art, avec la fierté et le sens de la responsabilité que signifie jouer devant des publics qui ne sont pas toujours des habitués du théâtre et des grands textes, Roland Lepage est demeuré fidèle aux exigences de son métier aux visages multiples, sans cesser de défendre bec et ongles le talent des acteurs et concepteurs de Québec, de leur rendre toute l’attention qu’ils méritent. C’est ainsi qu’à titre de directeur artistique du Théâtre du Trident, il imprime une marque encore visible aujourd’hui et permet à des générations d’artistes de théâtre de la capitale de s’affirmer dans de grands rôles et de grandes productions. Un engagement humain et artistique qui ne manquera pas de modifier le paysage du théâtre à Québec.
Sage et posé, mais également doté de cette faculté de s’emporter contre une époque qui ne fait pas à la culture et à l’art toute la place qu’ils devraient occuper, irréductible à une seule manière de faire, le caméléon Roland Lepage a tenu au chaud plusieurs amours, qui aujourd’hui le lui rendent bien et fleurissent en harmonie. Avec son flegme souriant, sa méfiance naturelle à l’égard des chapelles et des clans, sa pudeur et son bon sens, avec l’élégance d’un prince, il incarne la générosité même. Et il a réussi la prouesse, malgré les centaines de personnages qu’il a incarnés à la scène et à la télévision, de rester lui-même, ce Roland Lepage qui aime les mots, la rythmique et la musicalité des langues, l’univers fascinant du théâtre, l’Histoire et les histoires.