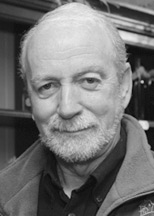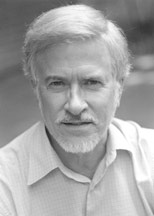Si l’on chauffe un gaz à une température très élevée, il finit par se transformer en plasma, une sorte de soupe d’atomes et d’électrons aux propriétés très particulières. Depuis bientôt 40 ans, le professeur Maher Boulos, également ingénieur, se passionne pour ce quatrième état de la matière, dont il est devenu l’un des meilleurs spécialistes au monde. À ses yeux, le plasma n’a pas qu’un intérêt théorique. Il recèle aussi un formidable potentiel d’applications industrielles que ce Sherbrookois d’adoption a mises en pratique en créant la compagnie Tekna Systèmes Plasma Inc., aujourd’hui leader mondial dans son domaine.
Maher Boulos naît au Caire en 1942, dans une famille de professionnels. Est-ce l’influence de son père, ingénieur civil, qui le pousse à se tourner vers des études de génie ? Peut-être. Mais c’est avant tout la créativité qu’il pourrait exprimer par l’entremise de cette profession qui l’amène à entreprendre, en 1958, des études pour obtenir un baccalauréat en génie chimique à l’Université du Caire. Après trois ans de pratique, le jeune ingénieur est attiré par le Nord, surtout par le Canada où un de ses oncles est déjà professeur. En 1966, il franchit l’Atlantique et reprend ses études à l’Université de Waterloo, en Ontario, où il s’installe avec sa conjointe Alice, une Suissesse rencontrée en Égypte.
Six ans plus tard, Maher Boulos quitte Waterloo avec, en poche, une maîtrise et un doctorat en dynamique des fluides et transfert de chaleur. C’est durant ses études postdoctorales à l’Université McGill qu’il découvre les plasmas, auprès du professeur William Henry Gauvin, père de la discipline au Québec et lauréat du prix Marie-Victorin 1984. Pour le jeune chercheur, c’est un véritable coup de foudre. Fasciné par cet état de la matière encore très mal connu, Maher Boulos se lance tête baissée dans ce nouveau champ de recherche. Jusque-là, les plasmas ont surtout intéressé les spécialistes américains et russes de l’exploration spatiale, qui les ont utilisés pour concevoir les boucliers de rentrée dans l’atmosphère des capsules. Maher Boulos entrevoit immédiatement bien d’autres applications, mais il prend aussi la mesure des défis à relever avant de pouvoir tirer parti des propriétés exceptionnelles des plasmas.
C’est à l’Université de Sherbrooke, où il obtient un poste de professeur en 1973, que l’ingénieur élabore son programme de recherche. Il y fera toute sa carrière, appréciant tout autant la qualité de vie de l’Estrie que les excellents rapports qu’il entretient avec cette université et son milieu. Pendant dix ans, Maher Boulos se consacre d’abord à la recherche fondamentale et acquiert bientôt une réputation internationale dans la conception de modèles mathématiques des plasmas. Cependant, l’ingénieur a besoin de concret. Lorsqu’il estime maîtriser suffisamment la théorie, il passe à la pratique et commence à explorer le potentiel technologique des plasmas en 1985, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et d’Hydro-Québec.
Très vite, Maher Boulos réalise que, bien que la recherche universitaire ait avancé dans l’étude des plasmas, l’industrie ne peut en profiter par manque d’équipements et de connaissances. En 1990, le professeur fait donc le grand saut et met sur pied sa propre compagnie, Tekna Systèmes Plasma Inc.. Soutenu par le Bureau de liaison entreprises-université, le professeur se transforme peu à peu en entrepreneur. Maher Boulos commence prudemment, avec de petits capitaux privés et son collaborateur et associé, le professeur Jerzy Jurewicz, à vendre sous licence de l’Université de Sherbrooke la torche à plasma qu’il a mise au point. En quelques années, la technologie acquiert une excellente réputation, et la compagnie Tekna Systèmes Plasma croît à un rythme soutenu. À la vente d’équipements, l’entreprise ajoute bientôt la conception de systèmes intégrés clés en main, puis de procédés complets destinés, par exemple, à la fabrication de nanopoudres pour l’industrie cosmétique ou la microélectronique.
La compagnie Tekna Systèmes Plasma est aujourd’hui un des moteurs économiques de la région sherbrookoise. Cette entreprise emploie 47 personnes, et les trois quarts de ses ventes ont lieu du côté de l’exportation. La firme de Maher Boulos compte parmi ses clients bon nombre des plus grands centres de recherche au monde, comme la NASA et le Los Alamos National Laboratory aux États-Unis, le Commissariat à l’énergie atomique en France de même que des compagnies comme Siemens en Allemagne ou Hitachi au Japon. Désormais leader mondial dans la technologie des plasmas inductifs, la compagnie Tekna Systèmes Plasma continue de prendre de l’expansion.
Malgré les succès, l’ingénieur poursuit sa mission d’exploration des plasmas et garde les pieds sur terre. Travaillant souvent de 60 à 70 heures par semaine, il n’a jamais cessé d’exercer son métier de professeur, à temps partiel au cours des dernières années puis comme professeur associé depuis sa retraite de l’Université de Sherbrooke en janvier 2007. Aujourd’hui encore, il supervise des étudiants de deuxième et de troisième cycles, qui se penchent sur les aspects plus fondamentaux des plasmas et peuvent ainsi publier leurs résultats dans des revues savantes. Auteur de près de 150 publications, de 2 ouvrages et de plusieurs chapitres de livres, organisateur de grandes conférences internationales et titulaire de 25 brevets, Maher Boulos a déjà reçu de nombreuses distinctions pour sa carrière exceptionnelle. Par exemple, en 2003, il a été admis au Temple de la renommée de la Thermal Spray Society aux États-Unis et a reçu le prix Armand-Bombardier de l’Acfas et le prix Innovateur de l’année de l’Association de la recherche industrielle du Québec (ADRIQ). En 2006, Maher Boulos et Tekna Systèmes Plasma ont reçu conjointement avec l’Université de Sherbrooke le prix Synergie du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
Aux yeux de Maher Boulos, le succès de sa compagnie reste pourtant le travail d’une équipe qui l’a appuyée de manière inconditionnelle depuis ses débuts. Marié depuis près de 40 ans, Maher Boulos tient aussi à rendre hommage à son épouse Alice, qui a accepté les sacrifices familiaux comme si elle était une partenaire à temps plein de son projet. Père d’un garçon et d’une fille, tous deux médecins spécialistes en Suisse, grand-père depuis quelques mois, Maher Boulos est resté très attaché aux siens malgré la charge de travail. Ainsi, il se rend régulièrement en Suisse pour passer du temps en famille, et il retourne à l’occasion en Égypte même s’il n’y a plus de proches parents. Sportif, il aime aussi barrer son voilier sur le lac Memphrémagog et espère, un jour, profiter d’une retraite bien méritée pour recommencer à peindre, une autre activité créatrice qui le passionne depuis l’enfance.