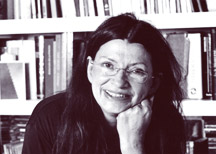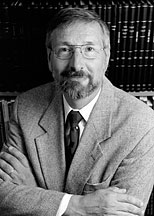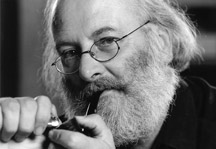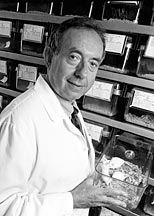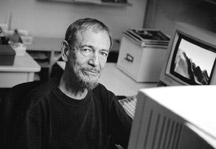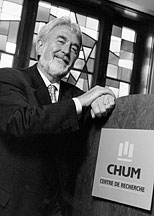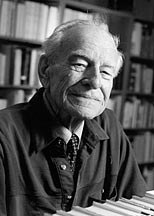Tous les amateurs de cinéma, artisans ou cinéphiles, connaissent
le nom de Robert Daudelin et savent ce que le cinéma, les cinéastes
et le public d’ici lui doivent. Cet homme d’une grande fidélité
incarne à lui seul les qualités essentielles à la constitution
et au développement d’un patrimoine culturel : stabilité,
continuité, détermination, ouverture, passion. Robert Daudelin
a su construire sa carrière autour de son amour du cinéma et il
a su mettre cet amour au service de toute la communauté québécoise.
Si le rôle et la nécessité de la Cinémathèque
québécoise ne sont plus à démontrer, si la préservation
et la diffusion du patrimoine cinématographique sont assurées,
c’est à Robert Daudelin que nous devons dire merci, car c’est sa
persévérance et sa foi inébranlable qui lui ont permis
d’asseoir sur des bases solides cette institution essentielle à la vie
culturelle de la nation québécoise.
Pourtant, rien dans l’enfance de Robert Daudelin ne laissait présager
qu’il jouerait un rôle important dans la conservation d’un patrimoine
qui en était alors à ses balbutiements. Né à West-Shefford
(aujourd’hui Bromont) au Québec en 1939, Robert Daudelin passe
son enfance dans son village ; ses premiers souvenirs de cinéma,
il les doit à la visite d’un missionnaire et au passage d’un projectionniste
itinérant qui s’arrête dans la salle paroissiale une fois la semaine
pendant les vacances estivales. Son père Alfred Daudelin, qui travaille
pour un marchand, a de grandes ambitions pour son fils et il souhaite que ce
dernier réalise ses rêves, qu’il exerce une profession libérale,
qu’il soit médecin ou avocat. Il inscrit donc son fils au Collège
de Montréal et l’y maintient en faisant d’énormes sacrifices financiers.
Mais au collège, Robert Daudelin s’ennuie ; alors il s’évade
aussi souvent que possible devant le grand écran.
Le jeune homme est conscient des attentes de ses parents, mais il sent que
son chemin ne sera pas celui qu’on lui a tracé. Son amour pour le cinéma
va grandissant. Alors, quand arrive le moment de choisir une profession, Robert Daudelin
n’entre pas à l’université, il commence à travailler :
il rédige des fiches de présentation de films et cherche comment
il pourrait gagner sa vie dans les milieux du cinéma. Il travaille à
Radio-Canada, entreprend des études littéraires, se marie et,
téméraire ou naïf, décide de partir à Paris
avec femme et enfants.
À Paris, Robert Daudelin fréquente la Cinémathèque
française avec son ami Jean Pierre Lefebvre, il se fait connaître
des milieux cinématographiques et passe des heures à discuter
cinéma, mais les emplois sont rares et le dénuement de sa petite
famille est tel qu’il émeut Guy Joussemet. Ce dernier aide Robert Daudelin
à compléter son séjour et à revenir au Québec.
En 1960, Robert Daudelin est cofondateur d’Objectif,
une revue indépendante de cinéma dont il sera également
le rédacteur en chef. En 1962-1963, il publie des textes, notamment
dans La Presse, Le Devoir et L’Actualité.
À son retour d’Europe, Robert Daudelin est responsable de la section
Cinéma canadien au Festival international du film de Montréal
dont il deviendra ensuite le directeur adjoint. Après avoir été
responsable de l’audio-vidéothèque du Centre audiovisuel de l’Université
de Montréal, il devient directeur général du Conseil québécois
pour la diffusion du cinéma et est élu au poste de vice-président
du conseil d’administration de la Cinémathèque. En 1971,
il est président de la Cinémathèque québécoise
et en octobre 1972, il en devient le directeur général. Toute
sa vie professionnelle sera désormais consacrée à faire
vivre et à faire évoluer la Cinémathèque québécoise.
C’est sous sa direction que sera construit, en 1975, le Centre de conservation
de Boucherville, qui sera agrandi en 1989 afin de répondre aux besoins
sans cesse croissants.
En 1974, le directeur de la Cinémathèque québécoise
est élu au Comité directeur de la Fédération internationale
des Archives du film où il occupera les postes prestigieux de directeur
général, de 1979 à 1985, et de président,
de 1989 à 1995. Parallèlement à ses tâches
administratives, Robert Daudelin, en vrai passionné, regarde sans
se lasser le cinéma d’ici et d’ailleurs et parvient à donner au
public et aux cinéastes un accès privilégié au patrimoine
cinématographique québécois, canadien et mondial. Il est
responsable de la chronique cinéma à l’émission Carnets
des Arts, à la radio de Radio-Canada, consultant à la programmation
auprès de festivals internationaux, coordonnateur de nombreux événements
consacrés à l’histoire du cinéma, membre d’un nombre incalculable
de conseils d’administration et de comités ; son influence, sa compétence
et sa passion sont partout reconnues. Sa rigueur et son éclectisme font
de lui un programmeur exceptionnel et c’est à son dévouement et
à son travail que la Cinémathèque doit sa notoriété
internationale.
Alors que la Cinémathèque comptait à ses débuts
sept ou huit employés, elle en compte aujourd’hui une
cinquantaine. Ses collections comportent des films rares d’ici et d’ailleurs,
des œuvres anciennes et d’autres inconnues qui enrichissent le patrimoine
cinématographique, ainsi que des documents télévisuels,
car il faut aussi vivre avec son temps.
Robert Daudelin, autodidacte du cinéma, se définit comme
un bon généraliste et affirme que tout dans le monde du cinéma
le stimule : voir les films, faire la programmation, bâtir la collection
et conserver la trace des objets. Il est fier de constater que l’institution
existe, que la place du cinéma dans la vie culturelle est désormais
acquise et que le septième art a droit à un lieu de conservation,
de réflexion et d’histoire. Il souligne la qualité et le professionnalisme
de l’équipe qui l’entoure et qui continuera le travail après son
départ. Cet amoureux du cinéma a rédigé et publié
de nombreux textes, mais il s’est fait réalisateur une seule fois, parce
qu’il est aussi amateur de jazz et aussi par amitié. Konitz : Portrait
of the Artist as a Saxophonist, un long métrage documentaire sur
le musicien américain, a été produit avec des amis et les
moyens du bord.
En 1994, Robert Daudelin a été fait chevalier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française et,
en 1995, il a été membre du comité d’honneur de l’UNESCO
pour la célébration du Centenaire du cinéma. Il accepte
le prix Albert-Tessier avec un plaisir sans mélange parce qu’il s’y trouve
en compagnie d’amis, de gens qu’il admire, de cinéastes qui ont construit
le cinéma québécois.
Robert Daudelin, en quittant la Cinémathèque québécoise,
s’éloigne d’un lieu auquel il a consacré 30 ans de sa vie,
parfois sept jours sur sept ; il ne saurait cependant s’éloigner du cinéma.
Enseignement ? Réalisation ? Écriture ? Il refuse
les projets trop précis mais il sait qu’il restera toujours un passionné
du grand écran et qu’il ne pourra jamais s’en éloigner.