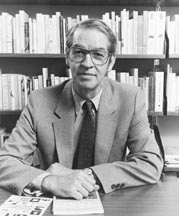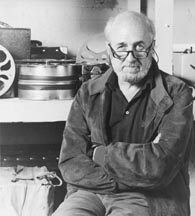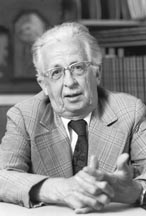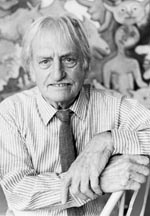André Barbeau était un «vrai » chercheur clinicien
dans le meilleur sens du terme, gardant toujours à l’esprit l’objectif
de soulager le malade et trouvant dans l’être souffrant toute sa motivation
pour agir.
Jean Davignon, chercheur, Institut de recherche clinique de Montréal,
hommage rendu au docteur Barbeau en 1986 par l’Union médicale du Canada.
Une renommée internationale
Neurologue québécois de renommée mondiale, le docteur
André Barbeau, qualifié de « clinicien de l’espoir »,
contribue pendant toute sa vie à l’amélioration de la santé
de patients atteints de maladies chroniques du système nerveux. Un des
premiers neurologues à faire d’importantes découvertes fondamentales
dans la compréhension et le traitement de la maladie de Parkinson, puis
de l’ataxie de Friedreich, André Barbeau est un guide dans le domaine
des maladies génétiques et héréditaires. Pour décrire
ses hypothèses et rapporter ses résultats, il s’applique durant
toute sa carrière à utiliser les langues de Molière et
de Shakespeare avec un brio exceptionnel. Plus de 25 années d’étude
sur le cerveau le conduiront à élargir le cadre des connaissances
de la neurologie classique et à donner un nouvel essor à la recherche
médicale concernant des maladies qui, jusque-là, représentaient
un véritable mystère pour la science.
Élucider l’énigme de la maladie de Parkinson
Dès le début de sa carrière en 1957, André Barbeau
s’intéresse de près à l’étude de la maladie de Parkinson,
alors négligée par la science. Après s’être initié
à la recherche avec le professeur Jacques Genest de l’Hôtel-Dieu
de Montréal, il se spécialise en neurologie à l’Université
de Chicago. Il entreprend alors ses premiers travaux de recherche sur cette
affection, caractérisée par la dégénérescence
des noyaux gris du cerveau, qu’il nomme lui-même la « maladie des
neurones ».
Invité à fonder le Laboratoire de neurologie de l’Université
de Montréal au début des années 60, André Barbeau
contribue dès lors, de remarquable façon, à la physiopathologie
et au traitement de la maladie de Parkinson. Le point de départ de son
ascension remonte à l’époque où il parvient à relier
la déficience en dopamine (substance retrouvée dans le cerveau)
à la maladie de Parkinson. Cette découverte, suivie d’une étude
systématique publiée en 1961, propulse le neurologue québécois
sur la scène internationale de la recherche. L’application de cette nouvelle
connaissance permet d’ailleurs la mise au point d’un premier médicament,
à partir de la DOPA, précurseur naturel de la dopamine dans le
cerveau. Capable de réduire les symptômes de la maladie, le traitement
se révèle une innovation sur le plan thérapeutique et est
universellement utilisé depuis.
En 1967, André Barbeau assume le poste de directeur du Département
de neurobiologie de l’Institut de recherches cliniques de Montréal, où
il installe son laboratoire, et continue ses recherches en vue d’améliorer
le traitement de la maladie, par la diminution des effets secondaires. Il devient,
en 1970, l’un des trois premiers médecins au monde à associer
une DOPA améliorée à une substance qui en augmente les
effets.
L’ataxie de Friedreich : de nouvelles avenues
de recherche
Sans abandonner ses recherches sur la maladie de Parkinson, le docteur Barbeau
se met à l’étude d’autres maladies neurologiques, dont différentes
ataxies, et plus particulièrement l’ataxie de Friedreich. Cette affection
irréversible provoquant l’incoordination des mouvements volontaires représente
alors une véritable énigme pour la science médicale, qui
ignore jusqu’à la description précise des symptômes. André
Barbeau devient l’un des premiers neurologues à franchir les étapes
importantes menant à la compréhension de la physiopathologie de
cette maladie.
Cette entreprise de longue haleine débute en 1975, à l’instigation
de Claude St-Jean, ataxique au courage exemplaire, fondateur de l’Association
canadienne de l’ataxie de Friedreich. André Barbeau institue et dirige
à ce moment-là une importante étude coopérative
portant sur cette affection. Au terme de dix années d’étude, le
neurologue et son équipe complètent un fragment essentiel de la
mosaïque des connaissances acquises sur la maladie. En plus de la découverte
d’un des facteurs causant les ataxies, soit la déficience biochimique
en acide glutamine, cet expert élucide la caractérisation claire
des différentes formes de la maladie, en distinguant une vingtaine d’ataxies.
Ces progrès faits à l’intérieur d’une aussi courte période
de recherche résultent de l’approche multidisciplinaire mise au point
par le docteur Barbeau pour aborder l’étude de la maladie. Son étude
coopérative, d’envergure internationale, suscite la collaboration entre
plus de 240 chercheurs venant de différents domaines de la science médicale.
« Son approche innovatrice a fait école, explique le docteur Serge
Gauthier, de l’Hôpital général de Montréal. Cette
méthode collective, où sont mises en commun les différentes
ressources scientifiques, s’est imposée comme modèle d’exploration
des maladies neurodégénératives, au point de représenter
aujourd’hui une tradition de recherche typiquement québécoise.
» D’ailleurs, la Fondation Parkinson du Québec, créée
en 1980 par André Barbeau, emprunte alors la même démarche
de recherche que celle qui est utilisée pour l’ataxie. L’hypothèse
de ce remarquable chercheur sera ainsi confirmée quinze ans après
qu’il en eut élaboré le concept.
Les voies de la génétique
André Barbeau s’intéresse tout particulièrement à
l’aspect génétique des maladies neurologiques. Ainsi, au début
des années 80, il ouvre la voie à une nouvelle science, l’écogénétique,
selon sa propre terminologie, d’ailleurs acceptée par la communauté
scientifique. Le chercheur amorce le mouvement de la science en démontrant
que, en plus d’une composante génétique, une composante environnementale
toxique est directement liée à la maladie de Parkinson.
La voie de l’environnement
À la toute fin de sa vie, le docteur Barbeau a débuté
des études rétrospectives sur les effets de l’environnement sur
la maladie de Parkinson. Les résultats préliminaires ont attiré
l’attention du monde entier. « Oui, l’environnement semblait favoriser
l’apparition de la maladie ». Son décès prématuré
a interrompu cette prometteuse observation. Cette hypothèse vient d’être
confirmée. À nouveau, selon le docteur Chrétien, le docteur
Barbeau a fait preuve de grande intuition scientifique et d’esprit de pionnier.
L’œuvre du docteur Barbeau se démarque particulièrement
par son caractère de continuité. Grâce aux travaux menés
au Québec sous la direction du neurologue, le gène de l’ataxie
de Friedreich est pour la première fois localisé par un groupe
de chercheurs anglais, deux ans après sa mort, survenue le 9 mars 1986.