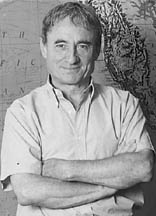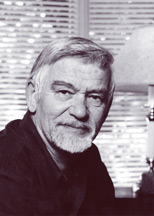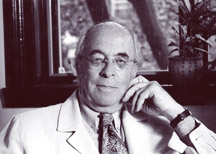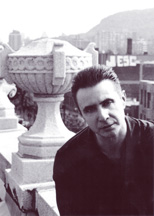Pierre Hébert a été fort surpris quand on lui a annoncé qu’il était le lauréat du prix Albert-Tessier. Se situant lui-même dans la marginalité du cinéma, ne sachant trop, comme il l’affirme souvent, s’il est pleinement cinéaste d’animation, ou uniquement graveur sur pellicule, ou tout simplement artiste multidisciplinaire, ayant une oeuvre qui, si elle trouve son compte dans une certaine audience, n’est pas largement distribuée, il s’interroge sur la signification de ce prix. « Dois-je le prendre comme une reconnaissance, une gratification ou une intimation à continuer? », se demande-t-il. Il y voit pourtant une opportunité : voir l’ensemble de ses films réunis en coffret vidéo, publier ses écrits qu’on lui a souvent suggéré de réunir, créer son site Internet dont il parle avec son fils depuis quatre ans.
Il faut dire que le travail de Pierre Hébert a suivi un long chemin avant d’être reconnu à sa juste valeur. On a maintes fois refusé son statut de cinéaste d’animation. Ainsi, pendant 20 ans, ses films n’ont pas été sélectionnés par le plus important festival du film d’animation, celui d’Annecy, en France. Ce n’est qu’au milieu des années 80 que son travail minutieux et hors norme commence à être reconnu. Il remporte alors plusieurs prix, dont celui de l’Association québécoise des critiques de cinéma, en 1985, pour Chants et Danses du monde inanimé – Le Métro . Le Melkweg Cinema d’Amsterdam lui en remet un autre en 1986 pour l’ensemble de son oeuvre. Il sera également, en 1988, le premier lauréat du prix Héritage-Norman-McLaren, prix donné à une personne dont le travail se situe dans le prolongement de l’oeuvre et de la pensée du plus célèbre cinéaste d’animation de tous les temps.
Or, c’est justement à cause de Norman McLaren que Pierre Hébert entrera à l’Office national du film (ONF) du Canada en 1965. Il l’avait rencontré quelques années auparavant, et cette rencontre avait été pour lui déterminante, car McLaren l’encourage fortement à poursuivre ses expériences d’animation gravée sur pellicule, technique qui, encore aujourd’hui, reste l’axe principal de son travail. Cette méthode d’animation, Pierre Hébert l’a pratiquée seul, chez lui, comme hobby, « avec beaucoup d’enthousiasme », dit-il. Elle demande peu de moyens et d’argent : des amorces de pellicule noire, des grattoirs, guère plus.
Né en 1944 dans une famille modeste du quartier Villeray à Montréal, Pierre Hébert dessine depuis l’âge de 5 ans. Ses parents encouragent certes ses talents, mais comme bien des gens à l’époque, ils l’inscriront au collège classique pour qu’il puisse embrasser une profession libérale. Son père est employé de bureau dans une sidérurgie et sa mère est couturière. « Je n’avais pas l’impression de vivre dans une famille pauvre, ajoute-t-il. Mes parents avaient des ambitions pour les enfants, souhaitant qu’ils étudient et fassent mieux qu’eux. Mais quand je suis arrivé au collège, disons que j’ai eu l’impression que ma famille était un peu pauvre quand même! »
Pendant ses études au collège Saint-Viateur, il aurait aimé, comme plusieurs de ses amis, fréquenter l’École des beaux-arts, mais ses parents s’y opposent fermement. On comprend son désir, car il a toujours dessiné, et il grave déjà à ce moment-là des histoires sur pellicule 16 mm non développée. C’est la Révolution tranquille et il s’intéresse au cinéma qui change du tout au tout à Montréal, avec la création du Festival international du film de Montréal, de la Cinémathèque canadienne (qui deviendra la Cinémathèque québécoise), du cinéma Élysée et l’explosion du Cinéma direct à l’ONF. Il rencontre les gens de la revue Objectif et il y publie des textes. « J’étais imbibé par l’esprit de l’époque », affirme-t-il.
Pendant quelques années, il suit deux chemins parallèles : son intérêt pour le dessin, l’animation et le cinéma, et son attirance pour les sciences. Il étudie l’anthropologie, qui le fascine énormément. Mais c’est à la suite de circonstances, heureuses ou malheureuses selon les points de vue, qu’il prend le chemin du cinéma, la fondation du Centre de recherches en archéologie de l’Université de Montréal, où il voulait entrer, ne se concrétisant pas. Il est alors engagé après un emploi d’été à l’ONF.
Cet intérêt pour les sciences marque tous ses films. C’est un regard d’anthropologue et d’entomologiste qu’on trouve dans Père Noël! Père Noël! (1974), Adieu bipède (1987) et La Plante humaine (1996). Sa passion pour les structures mathématiques se vérifie dans Op hop Hop op (1966), Opus 3 (1967), Explosion démographique (1967), Autour de la perception (1968) et Notions élémentaires de génétique (1971), aux constructions très raffinées et abstraites. Le calcul des probabilités lui étant nécessaire, entre autres choses, il retourne sur les bancs d’école pour étudier les mathématiques. En réaction à cette abstraction toutefois, à cette activité trop formaliste et quasi schizophrénique qui semble le mener à un cul-de-sac, Pierre Hébert décide de participer à des films collectifs, comme Le Corbeau et le Renard (1969), qu’il coréalise avec Francine Desbiens, Michèle Pauzé et Yves Leduc, et Du coq à l’âne (1973), qu’il signe avec Francine Desbiens et Suzanne Gervais. Il y acquiert la maîtrise du papier découpé et, très vite, l’idée d’animer. Son engagement politique y est aussi pour beaucoup alors qu’il adhère à des formations marxistes-léninistes. S’amorce, après une période de flottement, une prise de conscience qui le ramènera à la gravure sur pellicule, qu’il avait abandonnée depuis son arrivée à l’ONF.
Intéressé par Bertolt Brecht et son effet de distanciation, Pierre Hébert se questionne sur la technique et le récit. Afin de développer une critique sociale, il change le dispositif de ses films en faisant cohabiter images réelles et animation. Sa réflexion, plus réfléchie et plus théorisée, radicalise l’opposition entre différents styles d’animation, qu’on décèle dans Entre chiens et loup (1978), qui porte sur le chômage, et Souvenirs de guerre (1982), dont le propos est le danger d’une troisième guerre mondiale au Moyen-Orient. Mais la vraie remise en cause de l’animation démarre avec Étienne et Sara (1984), inspiré par la naissance de deux enfants, sa rencontre avec le poète belge Serge Meurant et sa collaboration étroite avec des musiciens. La recherche du métissage avec les autres arts se concrétise de plus en plus.
En voulant diffuser d’une autre manière ses films, Pierre Hébert a l’idée d’un spectacle avec deux musiciens, Robert M. Lepage et René Lussier. Cela donne Chants et Danses du monde inanimé – Le Métro (1985). La Lettre d’amour (1988) est issue d’une série de performances intitulée Conversations et réalisée avec un écrivain, un chorégraphe et un musicien. Des tournées suivent. Le cinéaste commence en 1986 à graver des films en direct, prenant ainsi une part encore plus active dans les spectacles. Avec Robert M. Lepage, il présente pour la première fois à l’automne 1990 La Plante humaine, une performance qui aboutira au long métrage de 1996, une critique féroce du culte des images.
Pierre Hébert devient en 1996 directeur et producteur du studio d’animation du Programme français à l’ONF. Il quitte cette fonction en 1999 et ne désire pas rester à l’Office en tant que réalisateur. « Je suis un cinéaste en dehors du cinéma, dit-il en riant. Je voulais poursuivre en toute liberté mes expériences sur la durée et l’espace. » Depuis 2001, il a entrepris une longue tournée, qui les a menés, lui et le musicien américain Bob Ostertag, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en France, au Portugal et au Japon, avec un spectacle toujours basé sur l’improvisation, Entre la science et les ordures. Il utilise cette fois l’informatique pour l’animation.
Cinéaste atypique, Pierre Hébert? Certainement. Mais aussi chercheur et penseur. Un grand homme de la science des images animées.