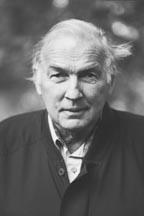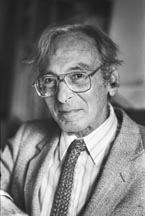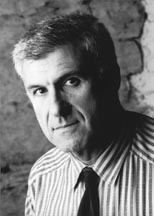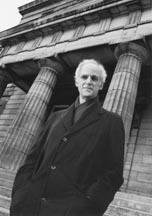Un philosophe de la modernité
Le monde de la philosophie contemporaine reconnaît, avec Sir Isaiah Berlin,
que Charles Taylor est « l’un des penseurs politiques les plus importants
de notre temps ». Exégète des traditions allemande, française
et anglo-américaine, familier de leurs poètes autant que de leurs
philosophes, Charles Taylor explore depuis 30 ans les sources culturelles et
philosophiques qui nourrissent le sens et la valeur que nous donnons à
nos vies collectives et individuelles.
Philosophe de la modernité, Charles Taylor propose à ses contemporains
le défi d’un pluralisme éclairé, soucieux d’intégrer,
plutôt que d’opposer, les valeurs contradictoires qui caractérisent
nos sociétés modernes : droits individuels chers au libéralisme
et aspirations collectives au cœur des mouvements communautaires et nationalistes.
Couronné par plusieurs prix, dont celui du meilleur livre en histoire
de la philosophie, publié aux États-Unis en 1989, son ouvrage
Sources of the Self : The Making of Modern Identity est déjà
considéré comme un classique. Préoccupé par la genèse
de l’identité moderne, Charles Taylor se penche, entre autres, sur le
sens de l’intériorité, sur la place de la vie ordinaire dans les
sociétés contemporaines et sur la conception de la nature comme
source morale.
Une des inspirations majeures de la réflexion de Charles Taylor est
de montrer que la philosophie morale contemporaine donne un portrait réducteur
et incomplet de la personnalité morale, qu’elle se soucie peu de prendre
en considération l’importance des déterminations historiques et
des orientations psychologiques.
L’histoire et le sens de la vie
L’œuvre globale de Charles Taylor est enracinée dans son expérience
de la complexité et de l’affrontement des identités canadienne
et québécoise. Né à Montréal en 1931, d’un
père canadien-anglais et d’une mère canadienne-française
et francophile, il constate, dès l’adolescence, à quel point la
langue forme l’esprit, permet de comprendre l’autre… ou alors de ne pas
le comprendre sans même s’en rendre compte! « Les thèmes qui
m’intéressent maintenant, la façon dont je les aborde, résultent
directement de cette prise de conscience », précise Charles Taylor.
Boursier Rhodes après un baccalauréat en histoire à l’Université
McGill, Charles Taylor entreprend à l’Université Oxford des études
de philosophie. Le courant de pensée dominant, « un positivisme
aride », ne le séduit guère. Cependant, l’obligation de produire
une argumentation écrite hebdomadaire, sous la direction d’un tuteur,
lui permet « de ne pas être imbibé, de se donner d’autres
maîtres, de défendre d’autres points de vue ». Dès
lors, jetant des ponts entre l’école anglo-américaine et les traditions
allemande et française dont elle s’est coupée, explorant plusieurs
sphères de la philosophie – langage, psychologie, éthique, politique
–, Charles Taylor développe une interprétation globale, nuancée
et ouverte de la modernité et des défis qu’elle pose.
Sa thèse de doctorat publiée en 1964, The Explanation of Behavior,
attaque de front l’étroitesse des modèles behavioristes et individualistes
qui dominent la pensée anglo-saxonne. Dans Interpretation and the
Sciences of Man, un classique qui paraît en 1971, puis au fil d’autres
articles réunis en 1985 sous le titre Philosophical Papers, Charles
Taylor poursuit sa réflexion sur les sociétés modernes.
Pour lui, l’être humain ne peut trouver de sens à ses actes et
à sa vie que dans la mesure où il agit dans une communauté
caractérisée par une culture, des institutions et une langue partagées.
Les partisans purs et durs des droits individuels, absolument réfractaires
aux biens collectifs, auraient ainsi perdu de vue une dimension fondamentale
du libéralisme.
L’action et la pensée politiques
Charles Taylor est un philosophe politique pour qui « l’engagement est
fondamental ». Rentré au Canada en 1961, enthousiasmé par
la Révolution tranquille, mais inquiet du désarroi du Canada,
il plonge une dizaine d’années en politique active, dans les rangs du
Nouveau Parti démocratique.
Depuis, Charles Taylor participe à tous les débats constitutionnels,
au gré de réflexions et de publications qui tentent de convaincre
le Canada anglais de la légitimité du nationalisme québécois
et de faire prendre conscience au Québec de l’héritage culturel
qu’il partage avec le Canada.
En 1975, le philosophe publie un ouvrage fondamental sur Hegel, « le premier
qui ait tenté de comprendre son monde à partir d’une genèse
de sa pensée. Qui veut faire ça aujourd’hui doit se situer par
rapport à lui. » Consacrant sa réputation internationale,
l’Université d’Oxford lui offre en 1976 la chaire Chichele en pensée
sociale et politique, la plus prestigieuse du genre au Royaume-Uni, qu’il occupera
jusqu’en 1981.
L’année suivante, Charles Taylor retrouve à l’Université
McGill le programme d’enseignement de la pensée politique, dont il avait
été le fondateur et l’âme dirigeante au cours des années
70. Réputé comme l’un des meilleurs en Amérique du Nord,
le programme attire des étudiants, « parmi les plus brillants »,
de partout au monde. On y vient en raison de la diversité des cours,
mais aussi du magnétisme de ce professeur admiré pour son érudition,
pour son art de la discussion philosophique et, surtout, pour une œuvre
d’une force et d’une indépendance remarquables.
Lauréat de plusieurs prix, sollicité de toutes parts, Charles
Taylor est invité dans les plus prestigieuses universités dont
celles d’Oxford, de Francfort, d’Harvard ou de Princeton.