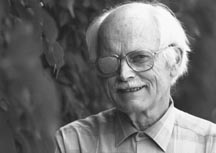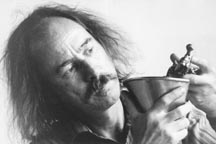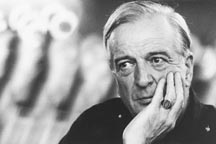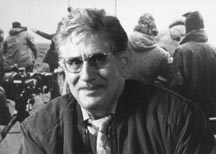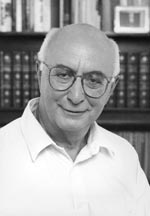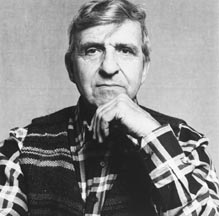Professeur émérite de l’Université McGill, Leo
Yaffe mène depuis ses débuts une brillante carrière de
chercheur et de professeur de chimie nucléaire. Pendant près de
50 ans, il saura communiquer son enthousiasme et son goût pour la recherche
scientifique à des dizaines d’étudiants diplômés,
devenus ensuite chefs de file dans leur domaine. Ses publications (au-delà
de 150) et ses conférences à l’échelle mondiale (pas moins
de 400 dans 20 pays différents dont l’Angleterre, le Japon, l’Italie,
l’URSS et la Chine) constituent une contribution éclatante au rayonnement
international du Québec.
L’énergie atomique au service de la paix
Leo Yaffe obtient, au début des années 40, un baccalauréat
en sciences et une maîtrise en chimie physique de l’Université
du Manitoba, qui lui remet quelques années plus tard, un doctorat honoris
causa en sciences. Cette période d’initiation à la recherche
marque une étape importante de sa formation, car il apprend à
mener une expérience à terme tout en conservant le détachement
indispensable à l’interprétation de résultats scientifiques.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, il déménage à
Montréal où il entreprend des études menant à l’obtention
d’un doctorat à l’Université McGill. Ses travaux portent sur la
mise au point d’un filtre pour la fumée, destiné à des
masques antipoison pour les militaires.
En 1943, le nouveau docteur est recruté par Énergie atomique
du Canada pour travailler en secret à l’Université de Montréal.
« Nous ne travaillions pas sur la fabrication de bombes, précise-t-il,
mais plutôt sur des utilisations pacifiques de l’énergie atomique.
» Le jeune chercheur se trouve rapidement plongé dans un univers
de recherche à caractère international. Plus de 200 scientifiques
renommés qui ont quitté l’Europe dévastée par la
guerre y formeront un groupe exceptionnel.
À la fin du conflit, l’équipe déménage à
Chalk River, en Ontario, où, pendant sept années, Leo Yaffe dirige
le Groupe de recherche en chimie nucléaire. Ce travail de recherche fondamentale
débouche sur quelques applications pratiques, particulièrement
sur la thérapie au cobalt. En 1952, Leo Yaffe revient à Montréal
pour enseigner à l’Université McGill, tout en poursuivant ses
travaux de recherche. Il contribue au développement de l’enseignement
de la chimie de cet établissement en élaborant deux nouveaux cours
de chimie nucléaire. Parallèlement, il poursuit ses travaux de
recherche fondamentale sur la fission nucléaire, qui débouchent
notamment sur l’utilisation de traceurs radioactifs en médecine. Il agit
aussi à titre de consultant dans divers hôpitaux, où il
préconise sans relâche une utilisation sécuritaire du matériel
de recherche radioactif, comme il le fait d’ailleurs dans les laboratoires de
l’université. Par ailleurs, il devient conseiller de la délégation
canadienne lors des Atoms for Peace Conferences à Genève, en 1955
et en 1958.
En 1963, le professeur Yaffe profite d’un congé sans traitement pour
se rendre à Vienne. Pendant deux années, il y dirige la recherche
et les laboratoires de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), organisation sous l’égide des Nations Unies, dont le mandat consiste
à diffuser les utilisations pacifiques de l’énergie atomique dans
les pays en voie de développement.
Un pédagogue hors du commun
Le séjour de Leo Yaffe à la direction du Département de
chimie, de 1965 à 1972, est perçu encore aujourd’hui comme l’âge
d’or de la chimie à l’Université McGill. En effet, au cours de
ces années, le personnel du Département double et l’on décerne
près du quart de tous les diplômes des cycles supérieurs
attribués depuis 1910, l’année du premier doctorat! Le Département
prend également la tête dans l’élaboration de méthodes
d’enseignement innovatrices. Leo Yaffe, reconnu pour son discours éloquent
et coloré, attire nombre d’étudiants de toutes les disciplines
dans son cours intitulé : « Introduction to Nuclear Chemistry ».
Le professeur-chercheur s’engage aussi dans des associations de chimistes.
En 1979, l’Institut canadien de chimie, qu’il préside pendant deux années,
lui attribue la Médaille de Montréal. Trois années plus
tard, l’Association américaine de chimie lui décerne l’ACS Award
for Nuclear Chemistry, la plus prestigieuse reconnaissance au monde en matière
de chimie nucléaire.
Malgré l’accumulation de tâches administratives, la recherche
et l’enseignement demeurent une priorité pour Leo Yaffe. Son rôle
de pédagogue en particulier lui procure beaucoup de joie, car, explique-t-il,
« la transmission de connaissances de génération en génération
demeure pour moi la plus noble des professions ». D’ailleurs, à
l’occasion de son 65e anniversaire de naissance, ses étudiants, collègues
et amis profitent d’un colloque sur la chimie nucléaire pour honorer
cette facette de son œuvre en créant le prix Leo-Yaffe, accordé
chaque année à un professeur de la Faculté des sciences,
en reconnaissance de l’excellence de son enseignement.
Au cours des dernières années de sa carrière, Leo Yaffe
se passionne pour un nouveau champ de recherche, l’archéométrie.
En collaboration avec des archéologues et des anthropologues, il scrute
des fragments de poterie. La composition atomique de l’argile qui façonne
ces fragments révèle leur origine géographique.
Au fil de sa carrière, Leo Yaffe défend toujours avec acharnement
l’utilisation pacifique de l’atome. Ses nombreuses participations à des
conférences internationales sur la question en témoignent. Jusqu’à
sa mort, le 14 mai 1997, il reste convaincu que l’utilisation sécuritaire
du nucléaire à des fins énergétiques est non seulement
possible mais essentielle. Son seul regret est de ne pas avoir réussi
à dissocier, dans l’esprit de la population, l’image de la bombe de celle
de l’énergie atomique dont il a tenté, pendant toute une vie,
de percer le secret.
Le souvenir de Leo Yaffe flottera sûrement éternellement entre
les murs de l’Université McGill ainsi que dans la communauté scientifique
canadienne et internationale. « Il a su intégrer l’honnêteté
intellectuelle, l’humanité et la vitalité à tout ce qu’il
a fait », se souviennent collègues et amis.