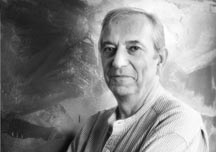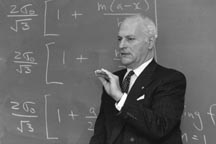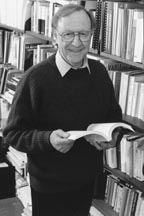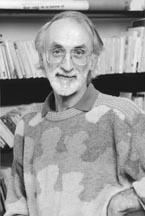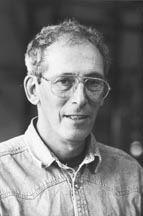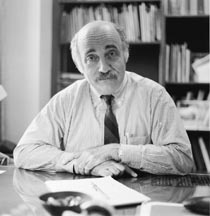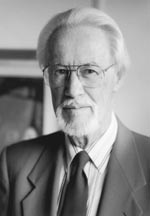Sans jamais négliger la recherche fondamentale, les travaux d’Yves Lamarre
en débordent depuis longtemps le cadre pour s’inscrire dans une démarche
scientifique d’envergure. À partir d’un certain nombre d’observations
sur le tremblement pathologique (du type parkinsonien, par exemple), les recherches
du docteur Lamarre évoluent vers l’étude de problèmes complexes
associés au système nerveux central et au contrôle de la
motricité chez l’humain et les primates. Leurs conclusions déterminantes
sont venues éclairer, notamment, un long débat relatif aux réflexes
transcorticaux et au rôle des données sensitives dans le contrôle
du mouvement.
Faire sa place
Diplômé de l’Université de Montréal en neurophysiologie
(1964), Yves Lamarre poursuit sa formation postdoctorale à l’Institut
Marey, en France, avec la professeure Denise Albe-Fessard (1964-1965), grâce
à une bourse du Conseil de recherches médicales du Canada. Il
travaille ensuite à l’Institut de neurophysiologie du Karolinska Institutet
de Stockholm (1965-1966) sous la direction du professeur R. Granit (Prix Nobel
de médecine), puis au Département de physiologie de l’Université
Johns Hopkins, à Baltimore, avec le professeur Vernon B. Mountcastle
et le docteur Gian F. Poggio (1966-1967). Depuis 1971, il est membre du Département
de médecine de l’Hôtel-Dieu de Montréal.
D’abord chargé d’enseignement, puis professeur adjoint à l’Université
de Montréal, Yves Lamarre y obtient l’agrégation en 1970 et y
est professeur titulaire depuis 1974. De 1990 à 1996, il dirige le Groupe
de recherche sur le système nerveux central de cet établissement,
après avoir assumé des fonctions identiques auprès du Centre
de recherche en sciences neurologiques de la même université (1977-1992).
Une contribution scientifique exceptionnelle
Yves Lamarre a recours à l’expérimentation électrophysiologique,
neuroanatomique et pharmacologique pour déterminer le rôle critique
des structures corticales et cérébelleuses dans la programmation,
la mise en action et l’exécution de réponses volontaires à
des stimuli sensoriels. Ces expériences constituent sa plus remarquable
contribution à la science neurologique. Il réussit à prouver
en effet, hors de tout doute, la genèse centrale du tremblement, contrairement
aux théories postulant l’intervention essentielle du système périphérique.
Le docteur Lamarre sera le premier à démontrer le site d’action
de l’harmaline, drogue d’origine végétale qui provoque chez l’animal
des tremblements comparables à ceux que l’on observe chez l’humain. Rigoureux
dans ses démarches, original par ses méthodes et souvent inattendu
dans ses conclusions, il fait également valoir que le système
nerveux constitue le siège d’une activité propre, rythmique et
bien organisée, absolument étrangère aux stimuli extérieurs.
Peu étonné d’avoir parfois surpris les autres, Yves Lamarre explique
avec naturel et bonhomie que le cerveau, dans les années 50 et 60, est
surtout considéré comme un centre d’acquisition et de traitement
de l’information d’où part, en retour, la réponse appropriée
aux stimuli. L’idée, depuis, a évolué. « La chose
est très bien acceptée maintenant, dit-il, notamment pour une
région directement reliée au cervelet. Il s’agit d’une structure
surtout motrice dont pourraient dépendre la synchronisation et la mesure
du temps… »
Par ailleurs, certaines expériences que le docteur Lamarre mène
à l’aide d’enregistrements de cellules corticales, avant et après
lésion du noyau dentelé du cervelet, lui permettent d’étudier
la transformation du signal sensoriel en signal moteur. Il caractérise
ainsi les décharges neuronales de structures centrales liées au
cortex moteur et, de là, conclut que cette transformation n’a pas lieu
dans le cortex moteur lui-même. Pour une autre série d’expériences,
plus poussées, il a recours aux techniques d’enregistrement unitaire
de cellules du noyau dentelé, ce qui lui permet d’analyser les temps
de réaction aux stimuli téléceptifs (perceptions non tactiles)
et d’établir le rôle du cervelet dans l’intégration sensorimotrice.
Faire sa marque au-delà de la recherche
En 1986, Yves Lamarre préside le congrès annuel de l’Association
des médecins de langue française du Canada, tenu sur le thème
suivant : « L’homme-cerveau ». Conférencier Sarrazin de la
Société canadienne de physiologie (1992) et membre de différents
organismes provinciaux, nationaux et internationaux, il agit également
comme représentant canadien auprès de l’International Brain Research
Organization (IBRO). Le IIIe congrès annuel de ce prestigieux organisme,
auquel prennent part 4 000 scientifiques, a lieu à Montréal en
1991 grâce à lui. Enfin, il dirige la Société canadienne
pour les neurosciences et différents comités relevant de la Society
for Neuroscience aux États-Unis.
D’autre part, avec le docteur Albert J. Aguayo, de l’Université McGill,
Yves Lamarre met sur pied et dirige le Réseau canadien des centres d’excellence
pour l’étude de la régénération neurale et la récupération
fonctionnelle du système nerveux. De 1990 à 1998, ce réseau,
l’un des rares du genre créés par le gouvernement canadien au
Québec, met à contribution 25 des principaux chercheurs d’une
douzaine d’universités et d’instituts répartis dans tout le Canada.
Il constitue un atout de première importance pour l’avenir de la recherche
neurologique au Québec et au Canada.
Le retentissement que connaissent sur le plan international ses recherches
et ses découvertes amènent Yves Lamarre à faire de fréquents
voyages à l’étranger. Outre les nombreuses conférences
qu’il prononce dans les universités du Québec et du Canada, colloques
et séminaires le transportent un peu partout dans le monde. Ses articles,
également nombreux, sont publiés dans d’aussi prestigieuses revues
que Journal of Neurophysiology, Science, Experimental Brain Research
et Acta Psychologica.
Chercheur à l’esprit ouvert et imaginatif, Yves Lamarre sait, grâce
aux techniques les plus avancées, apporter une remarquable contribution
à la recherche universitaire et médicale d’ici et d’ailleurs,
confirmant la vocation internationale du Québec dans le domaine des sciences
neurologiques. Ses brillantes réalisations illustrent de manière
éclatante sa puissance de conceptualisation, d’analyse et de généralisation.
Pour les autres chercheurs, elles constituent à la fois un exemple et
une source continuelle d’inspiration.