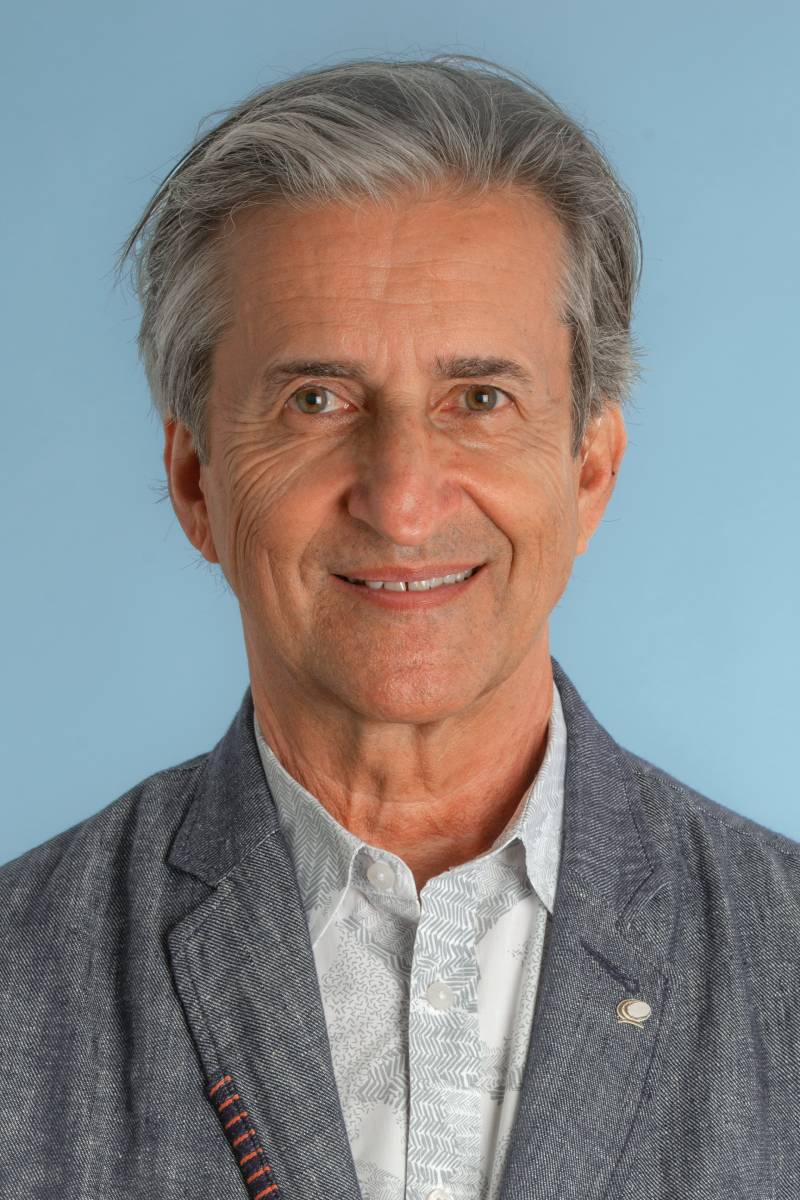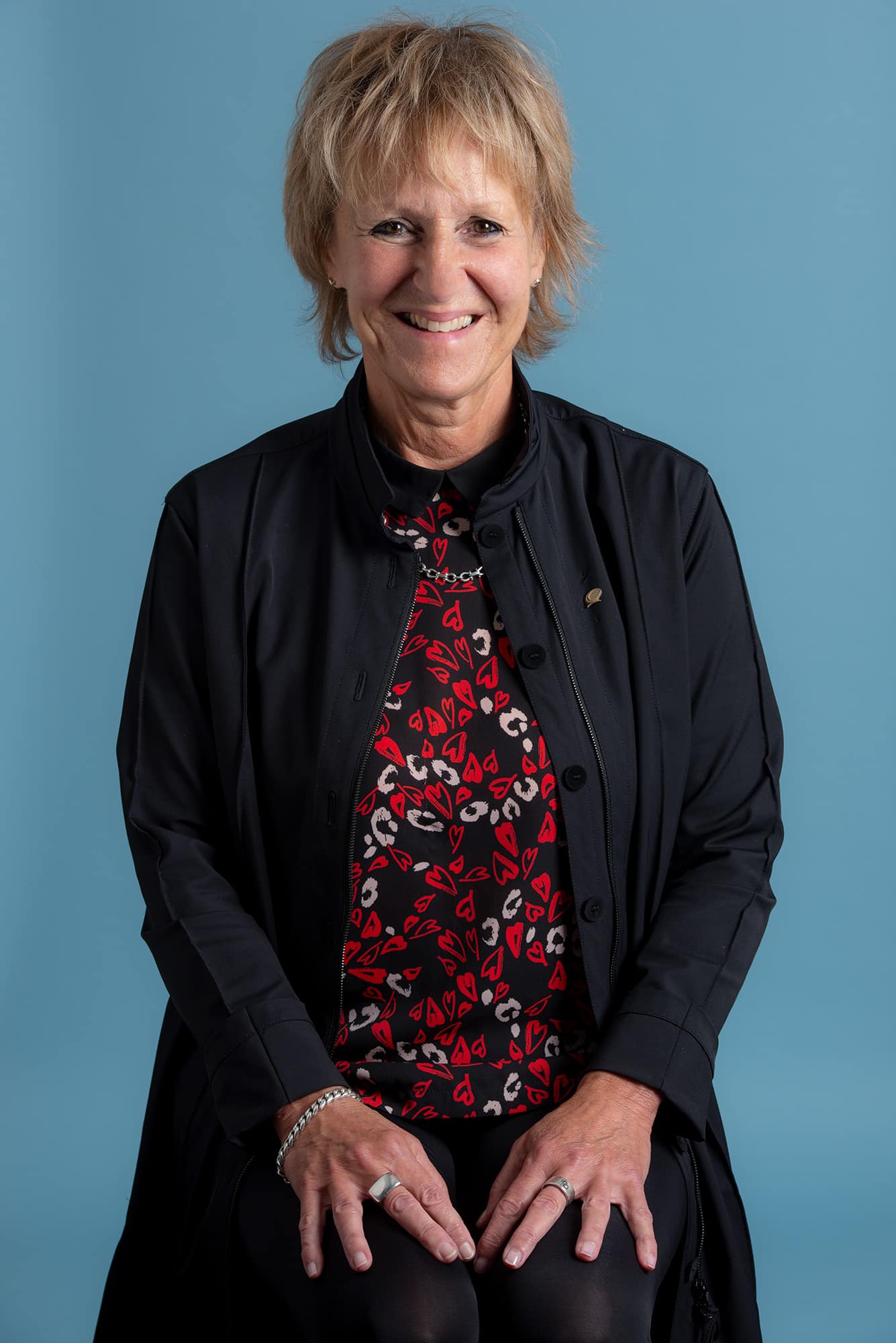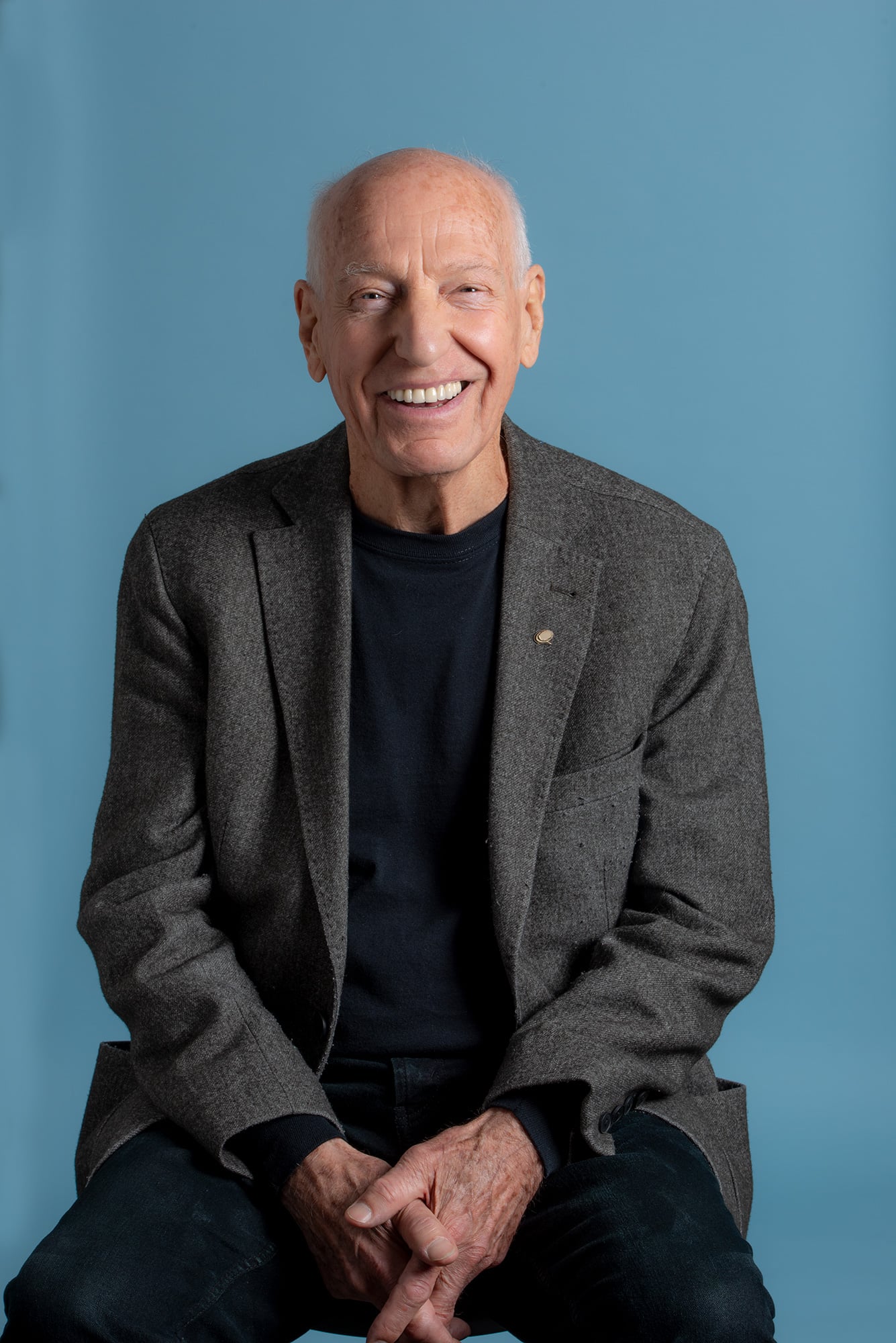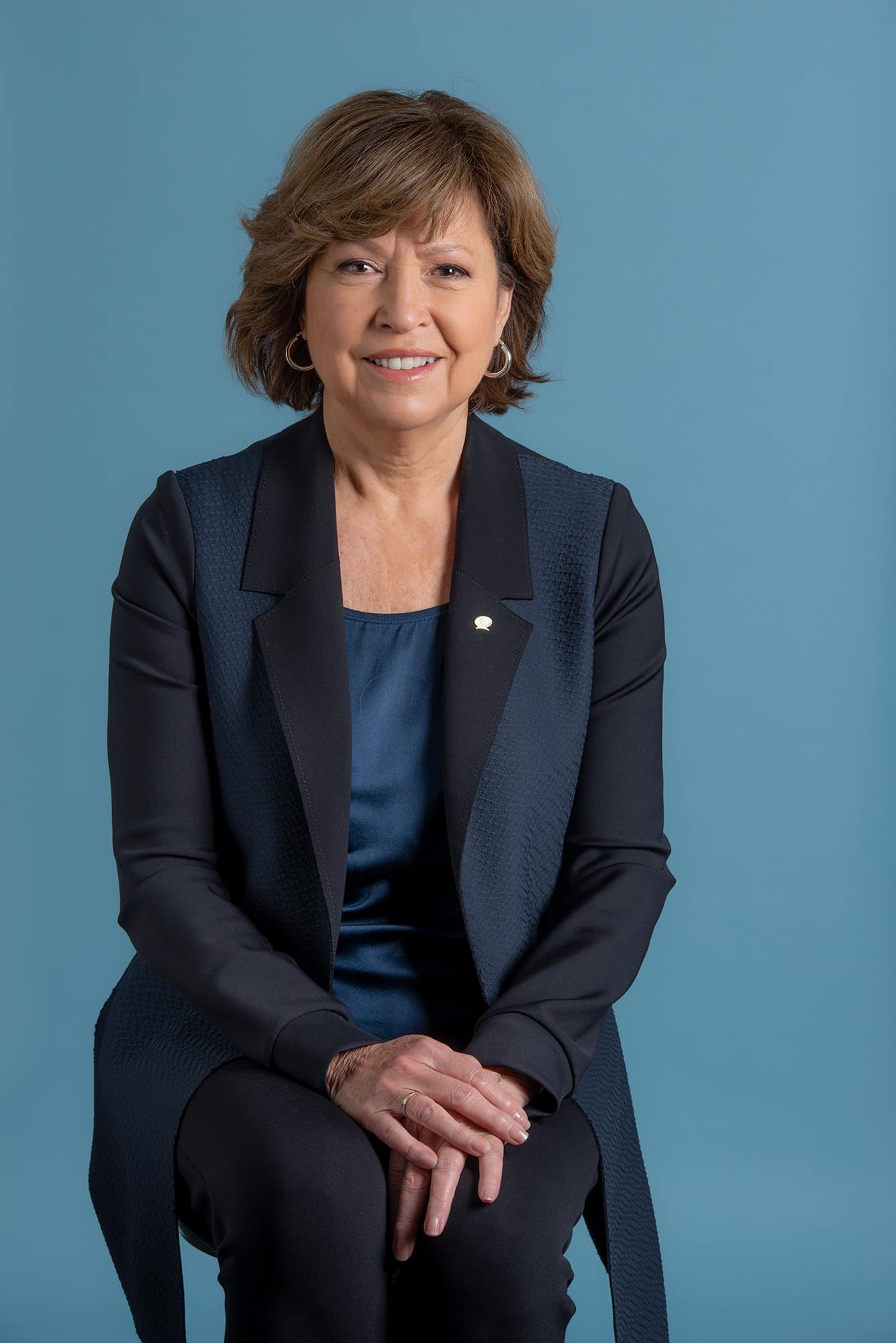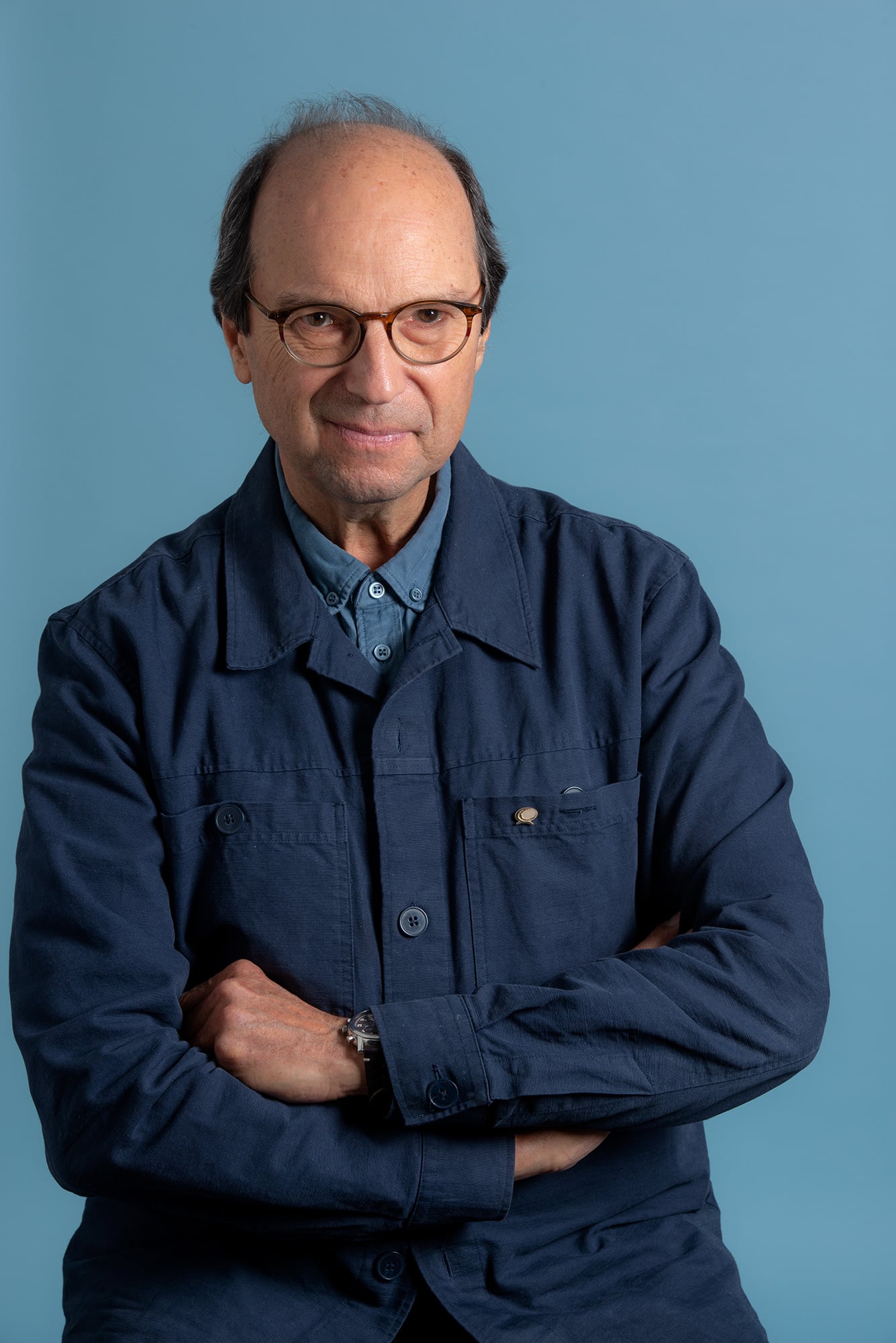L’essentiel est invisible pour les yeux, a écrit un auteur connu. Cette pensée pourrait s’appliquer au champ d’intérêt qui passionne le physicien Roberto Morandotti. Chercheur de renommée mondiale, ce professeur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) se spécialise en optique non linéaire et quantique. Il s’intéresse tant aux systèmes en espace libre qu’aux systèmes photoniques intégrés. Des domaines qui, on s’en doute, présentent des éléments de physique fondamentale peu accessibles aux profanes.
« Moi-même, à mes débuts, j’étais un peu découragé par la difficulté à saisir certains concepts », avoue avec candeur ce maître d’une discipline dont il a su percer plusieurs mystères. Ses découvertes ont non seulement fait bondir le savoir en la matière : elles propulsent aussi des avancées pionnières, en particulier dans les champs de la biomédecine et des télécommunications.
Quantique pour l’avenir
« La technologie quantique transmet l’information à l’aide de particules de lumière, appelées “photons”, plutôt qu’à partir d’électrons et de signaux électroniques, comme en informatique classique. Elle traite les données à une vitesse, à une efficacité et à un niveau de sécurité extrêmement élevés tout en étant moins énergivore », résume le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en photonique intelligente.
En apprivoisant le fonctionnement et les comportements encore inconnus des photons, Roberto Morandotti a pu mettre au point des dispositifs qui repoussent les limites des technologies actuelles tout en s’y adaptant. Ses travaux novateurs jouent un rôle majeur dans l’atteinte d’un objectif longtemps convoité par la communauté scientifique : l’ordinateur quantique et l’Internet du futur. Capables de tâches hyperpuissantes, ils permettraient, par exemple, d’exécuter des opérations chirurgicales de haute précision à distance. Ils offriraient également les moyens de simuler virtuellement des expériences multisensorielles avec un réalisme étonnant.
De la science-fiction? « Il y a 50 ans, le film 2001, l’odyssée de l’espace donnait un aperçu de l’actuelle intelligence artificielle. Dans 50 ans, c’est à l’univers d’Avatar que nous aurons accès. Ce que nous pouvons créer en quelques décennies est impressionnant. Pour moi, c’est un privilège d’œuvrer à la matérialisation de ce qui sera utile pour améliorer la vie des gens, de participer au futur de notre société. »
Fasciné par le futur
Ce fascinant futur l’allume déjà, enfant, dans son Italie natale où il se nourrit de Star Trek et d’histoires de robots. Doué, le jeune Roberto est curieux de tout. Son père le voit économiste; lui-même s’intéresse autant à la biologie qu’à la philosophie. Jusqu’à ce qu’une professeure de physique lui dise : « Ton talent est là, Roberto! »
Soupçonnait-elle qu’il deviendrait l’un des chercheurs les plus influents de sa génération dans cette branche? Qu’il compterait, quelque 35 ans plus tard, 289 articles dans les revues les plus prestigieuses et 34 500 citations par des pairs? Qu’il serait reconnu par plusieurs sociétés savantes, qu’il deviendrait fellow (membre) de la Société Royale du Canada, de l’Optical Society of America et de l’American Physical Society? Qu’il agirait comme professeur invité dans de nombreux pays?
Les contributions de Roberto Morandotti lui valent de multiples honneurs. Parmi eux, notons la Bourse commémorative E.W.R. Steacie en 2011, la distinction CRSNG Synergie pour l’innovation en 2019 et le prix Brockhouse pour la recherche multidisciplinaire en 2020, remporté avec son collègue de l’INRS, José Azaña.
La joie d’explorer l’inconnu
Pour en arriver là, Roberto Morandotti accepte de sortir des sentiers battus. Il le démontre dans les universités de Gênes et de Glasgow, où il fait ses études supérieures, comme à Israël et à Toronto, où il mène ses recherches postdoctorales. Lorsqu’il devient professeur à l’INRS, en 2003, il demeure animé de la même vision, qu’il transmet à sa précieuse équipe : « Se pencher sur des idées inédites, explorer l’inconnu. C’est plus complexe que d’expérimenter sur des pistes défrichées. Mais c’est nettement plus stimulant. »
« Osez! », répète-t-il à ceux et à celles qui viennent apprendre à ses côtés. Il en a supervisé plus de 165 depuis 2003, dont une vingtaine sont aujourd’hui titulaires de postes de professeur ou de chaires dans des institutions renommées. Roberto Morandotti en tire une grande fierté. « Publier dans des revues aussi prestigieuses que Science ou Nature donne beaucoup de satisfaction personnelle. C’est toutefois éphémère, car d’autres auteurs suivront bientôt, avec des résultats plus récents. Les jeunes, eux, représentent l’avenir. Mon rôle n’est pas de leur dire quoi faire, mais de les guider. C’est l’aspect le plus important de ma carrière. »
La relève l’apprécie. À preuve, le professeur Morandotti figure parmi les « Mentors exceptionnels » désignés en 2018 par la Canadian Association for Graduate Studies. Ce collectif pour la promotion de l’éducation supérieure réunit une soixantaine d’universités.
« À côtoyer les gens en formation, je reste jeune dans ma tête, se réjouit-il. Ils m’aident à maintenir la passion, la curiosité, le foisonnement d’idées nouvelles. » Et la suite? Le spécialiste de l’infiniment petit voit grand. « Inspirer, changer le monde. Rien n’est impossible. » L’enthousiasme de Roberto Morandotti vibre à la puissance de l’énergie quantique!